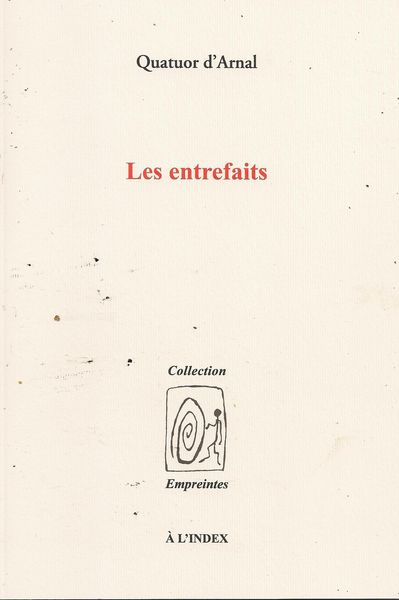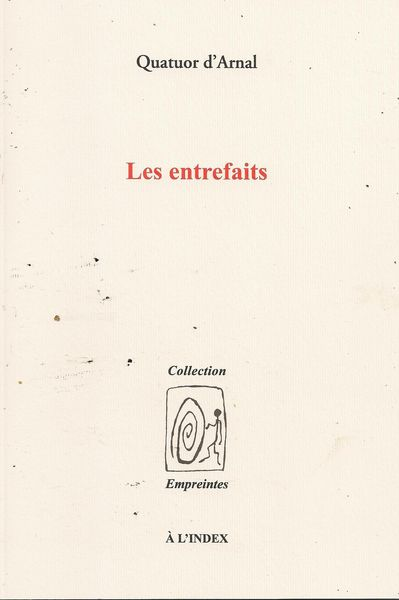LES ENTREFAITS par le QUATUOR D’ARNAL / Une chronique de JEAN-FRANÇOIS FOULON
éric CHRONIQUES de JEAN-FRANÇOIS FOULON 18 novembre 2024 4 Minutes

Curieux livre que celui-là, écrit par huit écrivains, quatre hommes (Michel Diaz, Jean-Claude Tardif, Yves Arauxo et Jean-Pierre Otte) et quatre femmes (Carmen Pennarun, Valérie Defrène, Valère-Marie Marchand et Myette Ronday). La première partie regroupe les poèmes écrits par les femmes, la seconde ceux écrits par les hommes. L’originalité de ce recueil, c’est que chaque poème est écrit en quatuor, les quatre auteurs (hommes ou femmes, selon le cas) intervenant dans sa composition. C’est un jeu (mais un jeu sérieux) qui fait penser aux cadavres exquis des surréalistes, mais qui s’en éloigne fondamentalement dans la mesure où chaque auteur a connaissance de ce qui a déjà été écrit par ses confrères. Il lui appartient alors de poursuivre le poème déjà ébauché.
Le premier (et ils sont premiers à tour de rôle) propose une ligne de départ. Les autres prennent le relais, mais en tenant compte des lignes précédentes. On aurait pu craindre un livre peu convaincant ou décousu, mais il n’en est rien. En fait, chaque auteur s’efface au bénéfice du poème qui se crée. On n’est pas en présence d’une œuvre anonyme comme au Moyen-Age (où un auteur souvent unique mais inconnu rédigeait un poème épique ou une chanson d’amour). Dans notre cas, le poème, écrit par plusieurs intervenants, n’est pas le propre d’un écrivain en particulier. En s’effaçant, chacun des intervenants a voulu laisser la poésie s’exprimer par elle-même.
Jean-Pierre Otte (qui vit au Mas d’Arnal à Larnagol, dans le Lot, avec Myette Ronday sa compagne) explique le projet dans une introduction. Chacun ajoute une ligne « sans que l’action d’écrire se fasse pour, contre ou avec les autres, mais uniquement en faveur du poème composé au fur et à mesure. » Il se crée alors « un esprit impersonnel dont chacun participe, et qui semble acquérir une sorte d’autonomie. (…) Ce sont des entrefaits, du verbe entre-faire, se faire l’un l’autre, fertilité dans l’intervalle. »
De son côté, Yves Arauxo définit la poésie comme un appel qui « ne convoque la vie personnelle que comme un vêtement qu’il s’agirait de déposer au vestiaire ». On n’écrit pas pour parler de soi, mais pour répondre à une injonction qui « vient d’un ailleurs en soi-même. » En faisant le choix d’écrire à plusieurs, en favorisant l’échange, les poètes se donnent l’occasion de quitter leur sphère personnelle pour approcher ce « noyau situé en marge des particularités de chacun ». Le but serait alors d’atteindre la spécificité de la poésie, un « idéal poétique, non pas celui de l’écriture d’un poème anonyme, mais celui de l’invention d’un poète qui ne porterait pas de nom. »
Le résultat est très convaincant. Les poèmes écrits en quatuor possèdent un esprit qui leur est propre, un esprit qui n’est pas simplement la somme de quatre sensibilités différentes. C’est comme si le poème s’était écrit lui-même, en-dehors de la personnalité des différents auteurs.
C’est là une démarche assez rare et qui mérite d’être soulignée. En effet, habituellement, chaque écrivain a tendance à revendiquer la paternité de ses œuvres et à se mettre en avant. Il veut qu’on le reconnaisse, lui, comme poète génial. Ici, seul compte le poème écrit, le lecteur étant incapable de détecter qui a écrit quoi. C’est donc là une belle leçon d’humilité de la part de créateurs par ailleurs bien connus de moi comme JP Otte, Myette Ronday ou Michel Diaz.
Ces poèmes nous parlent d’errance et d’éternité :
« Fouler de son pas l’errance des marées.
Les chevilles entravées par le reflux,
Faire sienne l’éternité océane. » (page 11)
Ils osent des comparaisons risquées, comme cette évocation d’un film où les deux héroïnes, après un long périple existentiel, finissent par se précipiter du haut d’une falaise :
« Mais comment à tout instant retrouver l’élan premier
Sans se précipiter dans le vide comme Thelma & Louise. » (p. 25)
Des questions sont posées :
Pourquoi la musique de la pluie est-elle si grave ? » (p. 30)
Des réponses sont données :
« Il cherche des mots pour exprimer son silence. » (p. 57)
« Le chemin mène toujours vers l’Ailleurs
Logé par crêtes et combes en nous-mêmes,
Hantant les chambres et les couloirs de nos cerveaux. » (p. 61)
Des vérités sont évoquées :
« Mais affronter le monde, comme la haute mer,
En invoquant moins les dieux que soi-même,
N’est qu’un trompe-l’œil fait pour les borgnes.
Les chers aveugles qui gardent les yeux ouverts. » (p. 63)
On tente de définir l’essence de la poésie :
« On rêvait d’un poème à l’oreille absolue,
D’une musique des sphères dans nos chambres de bonnes,
Des bruissements du silence dans les vergers d’absence. » (p. 65)
Et pour terminer, un autre extrait, dont on appréciera les images et les sonorités :
« Quand cette fille glacée nous prendra par la main,
Les aurores boréales auront les yeux vairons
Et, par des chemins lapons tatoués de lichens,
Nous déferons du froid les draperies secrètes.
Puis, nous divaguerons nus en troupeau dispersé
Entre des yourtes bleues et des nuages aimants,
Jusqu’à la dernière rive d’un rêve de verre. (p. 73)
Remercions les huit poètes pour cette production pour le moins originale, conçue au mas d’Arnal, dans un village du causse de Cajarc (un des quatre causses du Quercy), entre les méandres du Lot.
QUATUOR D’ARNAL, Les entrefaits, A l’Index, octobre 2024, 110 pages.