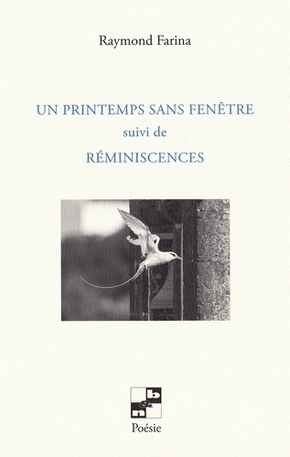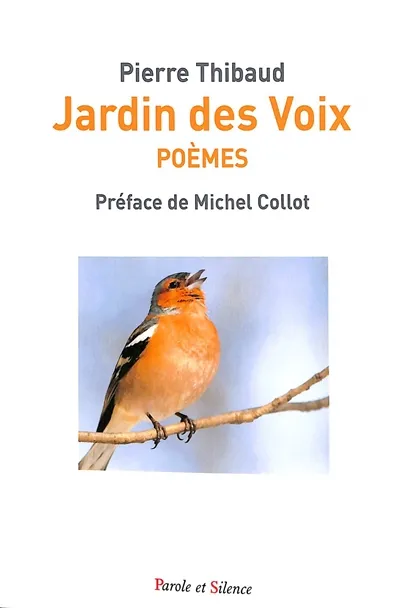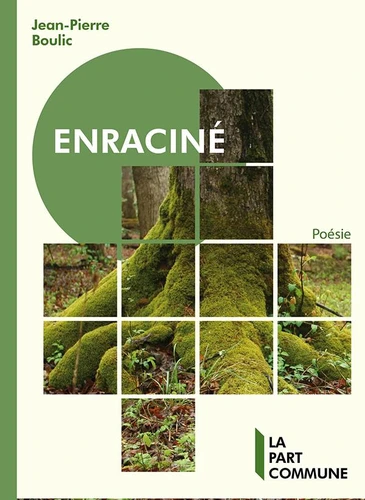
Enraciné, Jean-Pierre Boulic, La part commune (2023)
Note de lecture publiée in Diérèse N° 88 (automne 2023)
Ce nouvel opus de Jean-Pierre Boulic nous offre, après bien d’autres, de bien beaux et sereins moments de lecture. Des murmures d’images légères comme des envolées d’oiseaux, une pure musique du cœur toujours recommencée.
Ce recueil, composé de poèmes brefs, aux vers courts disposés la plupart du temps en distiques, tercets ou quatrains, divisé en 4 sections, Veille, Matin, Fête à venir, Hymne, commence pourtant par des notes sombres, comme une page de musique nous fait d’abord entendre la voix grave d’un violoncelle, ce qu’il cèle d’intime douleur. Ainsi, ces premiers vers : Tu n’as plus les mots / Qui disent ce que tu désires // Ton pas s’est arrêté / Au bord de ce banc. Ou ceux que l’on trouve dès la page suivante : Tu as la douleur / De ne plus savoir écrire / Le mot qui convient. Ailleurs, plus loin, ici et là, les mots ébauchent un paysage de froidure dans un temps aux couleurs meurtries et comme suspendu : Menaçants nuages / Terre recroquevillée / Attente du gel. Paysage d’automne ou d’hiver d’où la vie semble s’être retirée : Les bras vannés en décembre / Des peupleraies désarmées. Paysage qui semble isolé à la périphérie d’un monde déserté de feuilles, d’oiseaux et d’humains : Vents ébouriffés / Effeuillent les larmes / Des arbres fanés. Semble alors s’insinuer, dans ces premières pages, comme une sourde angoisse existentielle contre laquelle le poète nous paraît démuni : Tout tremble / De s’éveiller les mains vides / De ne pas entendre / Chants d’oiseaux et beauté des heures.
Mais ce serait bien mal connaître Jean-Pierre Boulic que de penser qu’il cède à l’ennui d’une saison, à la peine commune de vivre, à la tristesse ou aux tourments de l’âge, ou à la lumière crépusculaire qui menace ce monde. Ce serait aussi sans compter sur la nécessaire architecture d’un recueil qui nécessite que pour pouvoir atteindre de plus claires plages du cœur il nous faut, comme fait le plongeur de fond qui abandonne par paliers la mi-pénombre, remonter de manière croissante vers ce point de lumière qui, ainsi que je l’ai écrit ailleurs, « malgré la détresse, le désenchantement, l’indifférence, nous dit l’éblouissement de la création, le soleil de l’esprit et des mots ». Mais encore faut-il faire l’effort de se hisser jusqu’à ces régions secrètes de l’être où notre âme, allégée du poids de chagrin qu’à nous-mêmes nous sommes, peut épouser le souffle invisible qui passe sur la terre et tel un arbre y assurer l’innocence de ses racines.
Et « Enraciné », le poète l’est, mais autant dans sa terre d’Iroise que dans celle d’où germe toute poésie, celle qui chante l’homme en accord avec toutes choses, son effort quotidien et jamais accompli pour célébrer le monde, s’y reconnaître humble partie prenante indissociablement autant qu’indispensablement liée au vaste Tout de l’univers
Aussi, dès les premières pages, s’allument çà et là, quelque promesse de lumière, comme une braise qu’on croyait éteinte se ravive sous la cendre : Non ce n’est pas la blessure / De la neige du jardin / Dans l’ombre du sycomore / Mais un saut de rouge-gorge. Puisque en dépit de tout La vie balbutie / Cherche les miettes tombées. Ces minuscules miettes et ces modestes traces de la vie résiliente, le poète les quête et les cueille comme ce qui, du fond de l’espérance, persiste à demeurer. Et ce sera aussi bien une rougeur timide / Dans le trou du granit, ou les yeux vigilants du phare au large de la côte, ou la nuit qui entend les voix de passage / Dans un frôlement d’ailes, suscitant, grâce au silence / Un indicible chuchotement.
La seconde section, Matin, s’emploie à desserrer l’étau qui tenait d’abord enfermé Ce désir qui t’affame, cherchant Quel geste le délivrera / Te laissera respirer. Mais trouver l’apaisement exige que l’on œuvre à s’éclairer de silence, que l’on prenne soin d’écouter Le secret des images / Et de leurs couleurs. Il faut travailler à défaire les filets de la nuit, laisser le printemps surgissant apprivoise(r) ses paupières, ne jamais humilier les nuages, Croire à la trace / Des points d’envol / Que l’on découvre en chemin. Alors, écrit Jean-Pierre Boulic, Qui veut voir les événements / Sous le voile de leur mystère doit ouvrir sa main au matin Pour lui donner son grain, et croyant au vivant il pourra pleinement goûter la Merveille d’être créé / Et sans cesse de le dire.
Le titre de la troisième section, Fête à venir, est explicité par l’auteur, dès le premier poème : Par un enchantement / Le soleil ouvre l’œil / Et sa lueur présage / Peut-être la splendeur / D’une fête à venir. Et c’est un ciel traversé d’oiseaux, la rumeur calme de la mer et le susurrement des vagues, quelques gouttes qui tombent les feuilles, la respiration d’une légère nuit d’été, l’azur profond de l’océan, les mots qui ont l’odeur du vent, celle des arbres et des fleurs, un goéland posé sur une roche, la lumière du couchant qui oublie la clameur du jour, qui retiennent alors toute l’attention du poète. Tout ce qui, sous ses yeux, fait le monde et nous donne à voir La beauté du visage / De la terre et des ciels. Cet itinéraire de la joie, patiemment reconquise, est celui de quelqu’un qui pose ses petits cailloux dans un paysage où les arbres marchent, où l’on entend les parfums et couleurs du silence, où les barques semblent prier sur les galets des marées basses, où les songes viennent nicher / Dans ton cahier d’écolier, et où ce que le ciel ouvre à l’indicible est à portée de main sur la page vierge du ciel.
C’est dans Hymne, la dernière section du recueil, que la voix du poète, une fois épuisée La souffrance des blessures, peut pleinement s’accorder à Cet élan de l’âme comme à la vraie mesure de (sa) voix. Et cet exode intime vers le plus pauvre et le plus vrai de l’être est sans doute chemin de sagesse où Sur la harpe des branches / Où transparaît le vent / Une intime musique, il lui est donné d’entendre le souffle des sèves et d’apprendre l’oubli de soi, chemin d’humble patience sur la terre des hommes et sous le poids des jours.
Je ne puis résister ici au désir de citer ces quelques vers de Rilke, extraits du Livre de la Pauvreté et de la Mort : « Seigneur […] Oh, donne-nous la force et la science / de lier notre vie en espalier / et le printemps autour d’elle commencera de bonne heure ». Toute la démarche poétique de Jean-Pierre Boulic, de recueil en recueil, ne me semble pas être autre chose que l’inépuisable volonté de « lier sa vie en espalier » pour que le printemps toujours recommence, cette clarté tout intérieure mais qu’il sait si généreusement partager, cette clarté d’une Nouvelle genèse / Commencement du commencement / Horizon de la création.
Michel Diaz, 28/05/2023