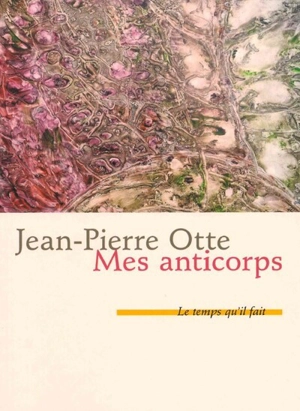
Mes anticorps
Jean-Pierre Otte
Le temps qu’il fait (2023)
Note de lecture à paraître in Diérèse N° 92
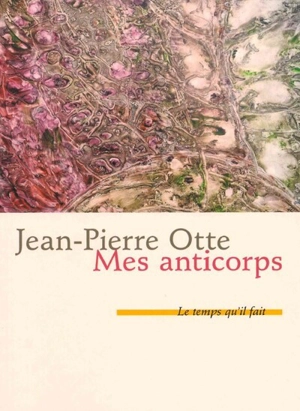
Mes anticorps
Jean-Pierre Otte
Le temps qu’il fait (2023)
Note de lecture à paraître in Diérèse N° 92
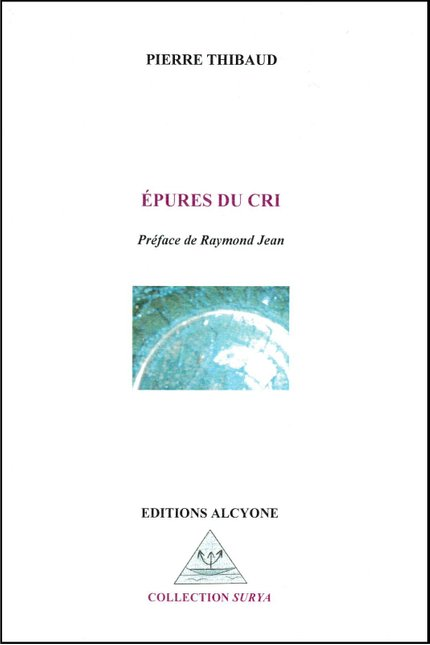
Epures du cri
Pierre Thibaud
Editions Alcyone (2024)
Note de lecture à paraître in Diérèse N° 91

Mont Ventoux, vues et variations
Angèle Paoli, Caroline François-Rubino
Editions Voix d’encre (2024)
Note de lecture publiée in Poésibao (12 juin 2024)
Nous connaissons Les Trente-six Vues du Mont Fuji deHokusai, une des premières séries, dans l’histoire de l’estampe japonaise, entièrement consacrée au paysage, série dans laquelle l’artiste a révolutionné l’art pictural de son époque. Et voici, comme en complice écho, ces trente-six vues et variations sur le mont Ventoux que nous propose ce très beau livre, illustré par les saisissantes peintures de Caroline François-Rubino qui accompagnent les poèmes d’Angèle Paoli. Le Ventoux, dont le nom siffle / à son étrave dure / et fend sans coup férir.
Point culminant des sommets du Vaucluse, surnommé le Géant de Provence ou le mont Chauve, le Ventoux, qui se hisse à presque 2000 mètres, est le seul de ces monts que son isolement géographique rend visible sur de grandes distances (et cela a son importance). C’est en raison de ces particularités qu’il fut et reste une figure symbolique de la Provence, qu’il a alimenté nombre de récits littéraires, et maintes représentations artistiques. Angèle Paoli nous rappelle d’ailleurs, dès les premières pages du livre, que la première ascension documentée du mont jusqu’à son sommet serait l’œuvre, le 26 avril 1336, du poète Pétrarque depuis Malaucène sur le versant nord : Ton plus ancien randonneur / et peut-être le plus célèbre // Pétrarque le toscan / amant de Laure de Noves. Francesco le toscan, dit Pétrarque, qui se lança / un clair matin dès l’aube / sur tes pentes ardues // […] n’emportant dans sa besace / qu’un peu d’eau fraîche / et de quoi subsister / sur la sente.
C’est dans cette lignée de témoignages et de documents que s’inscrit cet ouvrage qui rend hommage au mont en en faisant le seul et unique motif, représenté par la peintre toujours du (presque) même point de vue, les multiples variations étant essentiellement celles de la distance, d’un changement discret de l’angle du regard, ou l’emploi des couleurs et leur application sur le papier, sur lequel elles se diluent ou émergent en signes plus vifs, hachures, glyphes, traces de gestes, buissonnements de formes plus ou moins indéterminées (arbres, forêts, roches, replis de terrain, combes, ravines…). Mont Ventoux, vu toujours de loin, comme le mont Fuji sur les estampes. De fait, les Japonais disent souvent que c’est de loin que l’on peut comprendre au mieux sa splendeur. Et, en effet, dans cet ouvrage aussi, la beauté majestueuse du Ventoux apparaît dans toute sa force lorsqu’on la contemple, comme le fait Caroline François-Rubino, à partir des paysages environnants ou de certains promontoires. Images que l’on ne dira pas vraiment « figuratives » ou « représentatives » dans les procédés et les intentions de l’artiste, mais plutôt « figurales », donnant à voir des formes primordiales, des courbes initiales, des lignes de tension entre regard et traduction de sa vision, réel et interprétation de celui-ci, perceptible et imperceptible, coups de crayon ou de pinceaux réduits souvent à l’essentiel et amples plages de couleurs, fluides et détrempées, ou à la pigmentation saturée. Images lumineuses et solaires pour quelques-unes, rougies au feu du crépuscule ou se bornant à peu de chose comme le sont esquisses et épures, offrant l’espace d’une perspective ouverte sur les pentes et le lointain du mont. Dans les autres de ces images, l’essentiel du corpus, s’invite une palette de couleurs, relativement réduite, déclinaison de bleus, de gris, de bistres, de blancs et de noirs qui confèrent à ces images du Ventoux, brouillé de brumes ou noyé de nuages, au sommet caressé quelquefois par un léger ciel bleu ou rose, ou plongé dans les ombres de l’avant-nuit, peut-être celles d’un prochain orage, quelque chose d’un peu fantomatique et d’un peu inquiétant, voire de fantastique. Comme en ces moments où la brume surprend l’imprudent / pris par surprise / dans la nappe ouateuse, écrit Angèle Paoli, qui ajoute, plus loin, Il faut alors prendre patience / s’arrêter s’enrouler / dans ses laines / attendre qu’un rai de lumière / filtre et que soudain dans la lenteur / se dissipe la ouate dense. Car il arrive, lit-on dans l’un de ses poèmes, qu’un brouillard // – aussi dense que par nuit d’hiver – // enveloppe le Ventoux / le camoufle absorbe / sa lourde carrure / le fasse disparaître. Et la poète de nous dire encore : on en est quitte pour la peur / peur de l’avalement / peur de l’errance / peur de la chute peur / de disparaître. Car même si le mont Ventoux domine un paysage de vastes vignes / gorgées de soleil / qui s’étirent à ses pieds, paysage soumis à un régime méditerranéen qui déploie ses ors / ses mauves ses parfums / sa nonchalance / sa douceur de vivre / à l’ombre des platanes, il ne faut cependant pas trop s’y fier. Le Ventoux est un ours qui sommeille nous prévient la poète. Il peut y faire, pendant l’hiver, un froid glacial, pendant l’été, une chaleur caniculaire, et les pluies y sont particulièrement abondantes au printemps et à l’automne. L’eau de pluie qu’il reçoit s’infiltre alors dans des galeries et rejaillit au niveau des résurgences, parfois sous forme de torrents : Sur le flanc Nord du ventoux / plus secret et plus sombre // le long du torrent / Toulourenc / le château médiéval d’Aulan. En outre, son altitude induit aussi une grande variété de climats, de sommet au climat de type montagnard (végétation rampante / que l’on croirait imaginer / venue de l’Arctique) où s’invitent neige et brouillard, en passant par un climat tempéré à mi-pente. Le vent peut y être très violent (le mistral le balaie une bonne moitié de l’année) et les orages qui l’assaillent y sont terribles : Tu es là, nous le confirme Angèle Paoli, / fidèle au poste / blanc de neige et sapé / par le froid / sur blanc de rocaille // secoué par gros temps / caniculaire l’été.
Mais si le Ventoux est l’élément principal de cet ouvrage, il ne constitue pas pourtant, nous semble-t-il, son but essentiel. Le thème principal qui en ressort est davantage l’illustration du rapport entre l’homme et la nature. Et l’invitation à approfondir ce rapport se trouve là, justement, où l’homme n’est pas picturalement représenté (ce qui ne l’empêche pas d’être présent – à travers l’œil du spectateur, en même temps que dans celui du lecteur) : Au lendemain de la Libération / présence en ces lieux / de René Char // « Sur les hauteurs 1947 ».
Et cela nous conduit à évoquer le rapport entre la nature, l’homme et son besoin intime de spirituel puisque, revenant un instant à Pétrarque, nous savons que pour ce dernier le Ventoux, au-delà de sa réalité, devint le support symbolique de sa quête spirituelle, le théâtre propice à sa méditation, le chemin de sa conversion. Et qu’il l’invita à marcher / marcher où s’échancre la lumière, comme l’écrit Angèle Paoli citant Pierre-Albert Jourdan. Et le spirituel est la voie offerte au sacré. Ô divin Ventoux, écrit encore la poète, qui nous rappelle aussi le premier de ses noms, gravé dans la pierre // Vintur // à l’étymologie foisonnante / dieu du Mont vénéré / par les celtes. Car nous savons depuis toujours que tous les lieux où il y a quelque chose de sacré sont comme cela : isolés, entourés de solitude et de vent, très hauts, près du ciel. Comme nous savons aussi que dans toutes les croyances, la montagne apparaît comme un symbole de la transcendance spirituelle. Chaque religion possède une montagne, demeure des dieux, ou d’un dieu, lieu de pèlerinage souvent, marqué par le séjour de personnages historiques, lieux auxquels sont liés nombre de légendes, comme le mont Fuji que nous évoquions plus haut. Certes, à côté des 3776 mètres de ce dernier, le Ventoux n’est qu’un modeste sommet traversé de ces drailles (qui) ont ouvert / des sentes nouvelles / passages tout en sonnailles / et laines blanches / des troupeaux. Mais il n’empêche que, quand la masse nébuleuse des nuages recouvre le sommet du mont, seule émerge du dos à dos / une pointe effilée / qui perce de son aiguillon / le chapeau neigeux / du roi des nuages, lui accordant ainsi ses lettres de noblesse. Mont admirable nous dit Angèle Paoli, carène blanche, navire qui navigue ouvert à tous les vents / drossé par leur souffle. Et les mots de l’auteure en font ce vaisseau de pierre qui file droit devant / dans les nuits étoilées / mobile immobile / géant confiant / en sa puissance millénaire. Et l’on sent passer dans ces mots le souffle du sacré, que les mots du poème se retiennent de prononcer : ne demeure de son essence / que l’idée de son être / rivé en majesté / depuis des ères / posé là sur son socle / qui domine // la Provence. Sentiment du sacré qui pourtant se fait jour encore dans ces vers, Au-dessus de la Sainte-Baume / comme au-dessus du Ventoux / plane […] // le circaète Jean-le-Blanc, cet oiseau reconnu pour son admirable vol stationnaire et dont le surnom est « vol en saint esprit ». Comme dans ces autres vers, plus explicites encore : le Ventoux lisse / son visage tutélaire / de divinité. Ou ceux-là, qui évoquent les profondeurs mystérieuses de l’être, touché par la révélation de ce qui le dépasse : Les voix du dehors / s’assoupissent s’apaisent / qui laissent filtrer diffuses // […] les voix du dedans.
Si nous ne sommes pas ici (et pourtant pas si loin…), dans la conception shintoïste du monde, cette religion japonaise basée sur la vénération des dieux et des esprits, en syncrétisme avec la nature et qui met l’accent sur la signification spirituelle de phénomènes naturels tels que les montagnes, les rivières, les arbres et les pierres, nous sommes malgré tout, dans la contemplation du mont Ventoux telle que cet ouvrage nous la propose, invités à marcher sur la « voie des dieux ».
Mais nous nous contenterons, inspiré par le beau travail d’Angèle Paoli et de Caroline François-Rubino, d’évoquer ces deux autres chemins. Le premier, celui de René Char dans sa Lettera amorosa : « Je vais souvent à la montagne dormir. C’est alors, en vérité, qu’avec l’aide d’une nature à présent favorable, je m’évade des échardes enfoncées dans ma chair, vieux accidents, âpres tournois ». Le second de Jacques Dupin dans son poème Sang, in Dehors : « alors il va aux montagnes / de préférence – grises / et rauques, s’aguerrir / et sa vieille torpeur mettre en pièces ». Deux chemins de la paix de l’âme, que ces mots d’Angèle Paoli ne peuvent qu’approuver : Le Ventoux / dans son silence habité / par les grands souffles // libère l’espace intérieur.
Michel Diaz, 31/05/2024
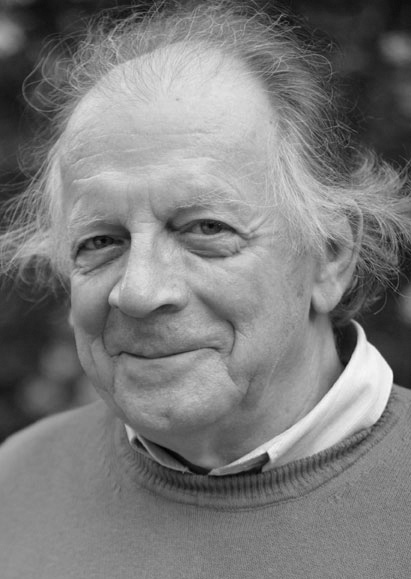
Eveil trois fois
Pierre Dhainaut
Les Carnets du Douayeuf (2024)
Note de lecture à paraître in Poésie sur Seine
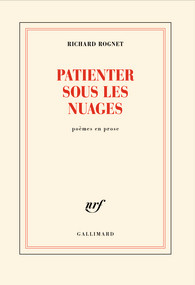
Patienter sous les nuages
Poèmes en prose
Richard Rognet
Editions Gallimard (2024)
Note de lecture à paraître dans le prochain numéro de Poésie sur Seine