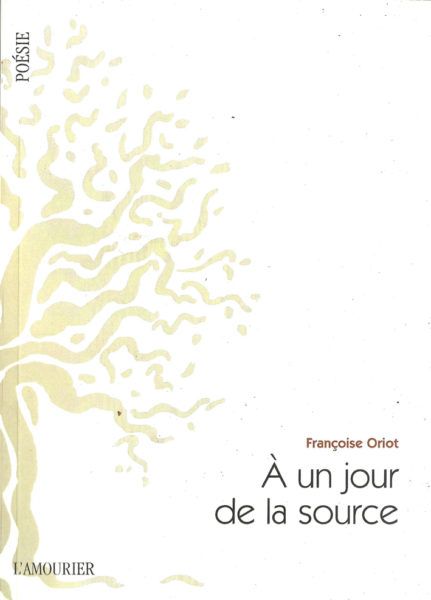
A UN JOUR DE LA SOURCE – Françoise Oriot – Editions L’Amourier – 2015
Chronique publiée sur le site des éditions L’Amourier, sur le sites Terres de femmes, TalentPaper blog, et dans le N° 36 de L’Iresuthe.
C’est sous forme d’hommage discret à René Char (auquel sont empruntés les mots de son titre) que se présente cet ouvrage divisé en quatre chants, Guetter les signes, Bien sûr les pierres dressées, J’ai jeté ma pierre et Perdue choisie.
« A un jour de la source », mais combien de pas pour l’atteindre ?… Impossible distance à combler pour qui marche les pieds meurtris et l’âme fatiguée, vers un là-bas qui est ce que nous y faisons advenir, impossible distance, mais la seule à franchir pour qui veut étancher la soif de son désir et y goûter, du bout des lèvres, « la fragile raison de la vie ».
Car la vie est ici, maintenant, en deçà de toute illusion d’un monde transcendant, puisque « aucun mystère/ni d’ici ni là-bas ne (nous) requiert », et l’on peut se risquer à entendre ainsi (comme on jette une pierre à l’éternel silence du Très-Haut), cet « oasis là-bas/vous ne l’atteindrez pas », puisque encore en dépit de tous nos mensonges, de nos mythes et paraboles, cette oasis « n’existe pas ».
Nous voici en tout cas dans la contingence, dans un monde sans dieux, responsables uniques de nos caprices, livrés à notre seule solitude humaine et aux entreprises de sa folie, sous l’œil indifférent des astres, n’ayant sous le soleil des jours que la flamme de l’espérance à toujours inventer pour obstinément témoigner de l’infinité du réel, en approcher la source, et « pour retenir le rythme du chant ».
C’est bien la vie, et sa multiple profusion, dans ce qui se murmure à notre oreille du lourd secret des choses et que masquent nos mots sur nos lèvres, que le poète invite dans ses pages et exalte à voix retenue, même métaphoriquement, sous la forme du végétal, de l’animal, du minéral, comme dans ses aspects les plus élémentaires – ceux de l’eau et du feu, de la terre et du vent, l’arbre, la lune, la pie ou l’araignée. Ces textes, habités des diverses présences du monde, nous en proposent une approche sensible, une re-connaissance qui nous le restitue intense mais fiévreux, où s’exerce l’enjeu le plus grave qui soit, celui d’appartenir en bonne intelligence à la communauté des êtres et des choses dont nous ne sommes que les douloureux, fragiles, mais indispensables maillons de la chaîne.
Car vivre est, en effet, expérience mortelle, épreuve de douleur qui « jette la tête contre les murs », mais ne nous laisse d’autre choix, souvent, puisque « souffrir c’est vivre encore », c’est-à-dire essayer de persévérer dans notre être. Etre au monde, c’est être du monde, mais otages non consentants de la finitude de notre temps terrestre qui ne nous nourrit de lui-même que pour autant qu’il nous dévore. Etre du monde fait de nous des « êtres-pour-la-mort », figurants d’une pièce où s’imposent « la pluie cinglante/la montagne qui crache ses laves/le froid mortel/l’océan qui engloutit ».
Françoise Oriot sait que le drame de l’espèce humaine et son désordre permanent, insulte à l’ordre impermanent des choses, ont aussi pour décor la mise à feu et sang des espérances, et la violence du monde, les crimes et massacres organisés, « le mépris/la délation« , et ce qui fait de nous des égarés sans boussole ni horizon. Et l’on peut se permettre de penser à Shakespeare qui estimait que le « malheur du temps (était) que les fous guident les aveugles ». Sommes-nous devenus plus sages ?
Ces textes ne font pas silence sur ce qui fonde le tragique de notre présence au temps et au monde, un monde où « il faudrait, nous dit l’auteure, réveiller la moitié de l’humanité/et consoler l’autre moitié ». La voix est souvent douce, mais surtout ferme et grave, et cela lui suffit, comme on chante dans la pénombre ou qu’on prie à voix basse, à se faire l’écho de ces cris dont l’horizon rougeoie et qu’ils peuplent, là-bas, tout autour, de « colonnes de cendres ».
Dans ces pages, c’est l’aujourd’hui du monde qu’elle invite, et dont elle nous demande d’en « guetter les signes » avec elle. Et contre le silence de l’indifférence ou la peur, avouée ou masquée, qui nous jette toujours à la gorge de l’Autre, elle se fait devoir humain et fraternel de n’avoir pas, sous les bourrasques, « hurlé avec les loups ».
Et c’est dans ce compagnonnage fraternel que nous avançons à travers ces chants qui interrogent le mystère d’être de ce monde, l’énigme que nous sommes à nous-mêmes « entre deux gouffres d’inconnu », ayant toujours à faire avec ce qui nous hante et au plus profond nous tourmente, et qui sont nos propres démons.
Vivre, c’est cheminer sur l’étroite ligne de crête qui relie ces deux bords de nous-mêmes qui ne se rejoignent qu’à l’horizon, à l’endroit même où nous ne sommes plus qu’un nom, vide de toute présence, mais qui à lui seul nous résume pour l’infini des temps. Vivre, nous dit Françoise Oriot, c’est s’avancer, face offerte au soleil, essayer de capter cette « intelligible lumière » dont nos yeux aveuglés ne peuvent rien saisir, sinon cette brûlure où se consume toute vérité. Mais malgré l’inquiétude qui traversent ces pages, ces mots de désenchantement face à ce monde dont nous sommes de très mauvais gérants et de bien ingrats locataires, et face au Mal dont nous ne sommes que les seuls artisans, l’auteure nous confie encore que, parfois, lui « revient sans colère », et aux heures de grâce, le sentiment « que le tragique avive au plus vif/l’humain dans l’humain ».
C’est bien cette notion « d’humanité », mais éclairée de grave bienveillance et de lucide compassion qui constitue la trame de ce livre, car demeure toujours ce qui, en toute poésie, mot contre mot comme font pierre contre pierre, embrase la parole et lui donne son sens : atteindre le bord de la source, « atteindre le rivage » pour « s’agenouiller sur la plage/sauve ».
Le dernier chant de cet ouvrage, qui en fait son point d’orgue, le prolongeant dans ce qu’il a d’intime et de plus personnel, évoque l’entrelacs dans lequel, s’exaltant, se fortifient d’eux-mêmes et s’abîment les rapports amoureux. Succédant aux ivresses des sentiments et aux « rires d’après le plaisir », cette ascension, à l’empyrée du cœur et des corps confondus dans l’étreinte, de cette « étoile double/au centre de gravité commun », surviennent, comme en tout amour qui s’achève, le déclin et la solitude, la perte et ce que l’on devine de la mort quand ne demeure plus en nous que « le fantôme de la fuyante jouissance ». Mais là aussi, comme en toutes les pages qui précèdent, l’auteure se rassemble pour ne pas céder aux mots de la douleur, et pour que ne vienne plus l’entamer la souffrance, fait des cris retenus la parole qui la libère. Ainsi, « la pierre devient socle » sur lequel elle assoit la « force assoiffée des mots qui consolent des cris ».
« L’eau est lourde à un jour de la source » écrivait René Char. Françoise Oriot nous montre ici que marcher vers la source, en usant de persévérance et de force d’insoumission, peut nous aider, qui la lisons, à la rendre un peu plus légère. Contre l’infortune des temps et le questionnement anxieux sur ce qu’à nous-mêmes nous sommes, comme contre les voix discordantes du cœur, il lui reste, tenace, ce qui reste au « chèvrefeuille harassé/contre le mur de la cour », la volonté fervente de rester en éveil et de traduire en mots ce que nous conservons en nous, vivant, de la beauté du monde, qui se traduit ici, dans le partage, par « le grand bonheur de savoir donner/au printemps/des fleurs blanches et parfumées ».
Michel Diaz – [Tours – 01.10.15]