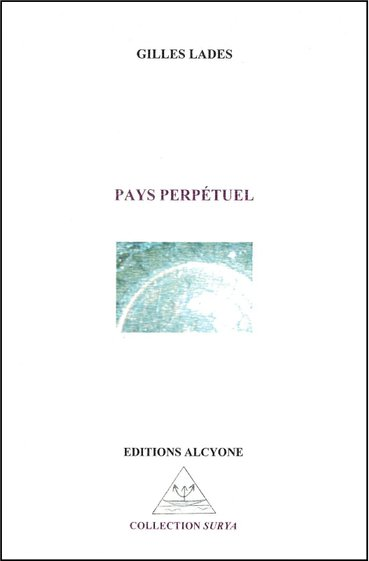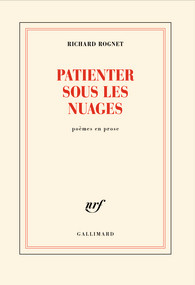
Patienter sous les nuages
Poèmes en prose
Richard Rognet
Editions Gallimard (2024)
Ces poèmes en prose, écrits entre 2016 et 2019, sont composés, pour beaucoup d’entre eux, de longues phrases, voire d’une seule qui occupe tout l’espace du texte, semées d’anaphores et de formules qui donnent à ces textes l’allure d’une lente confidence crépusculaire où apparaissent çà et là des éléments autobiographiques, comme se délivre de l’ombre une voix dans laquelle l’auteur, toujours présent sous la forme du « je », nous accompagne, page après page, dans une langue simple, souple, quelquefois familière, si près de nous que nous pourrions sentir sa main posée sur notre épaule. La voix de Richard Rognet, grave et sombre souvent, aux accents volontiers élégiaques, est d’abord cette voix amie qui chuchote et murmure, sans jamais hausser le ton, s’enroule et se déroule comme va un ruisseau sous le couvert des arbres, charriant, blessé de pierres et de branches mais irrésigné, ces éclats de furtives lumières dont nous éblouit la soudaine émergence.
Cheminement paisible mais tenace de ces mots, assombris cependant de questions sans réponse et de sourde inquiétude. Cheminement des mots, comme chemine la vie même et cheminent les souvenirs, les images d’un monde où l’on se demande toujours quelle y est notre exacte place : Les chemins, ô les chemins ! qui conduisent mes pas jusqu’aux murs étouffés sous les ronces brûlantes, jusqu’aux rêves rêvés sous des rêves infinis, jusqu’aux fleurs en allées, jusqu’aux enfants perdus dans les tumultes de la vie.
Ces lignes, qui ouvrent le recueil, donnent déjà le ton de tout ce qui va suivre, laissant à la poésie, le meilleur des guides, le soin de creuser la mémoire et d’orienter le regard à travers la réalité, vers ce qui peut venir la trouer, ces riens – c’est cela le réel – qui se laissent rencontrer et souvent dans l’inattendu. Ces riens qui ouvrent des passages afin d’offrir à la réalité cette chance de vie. Mais encore faut-il, pour que puissent s’ouvrir ces passages, se confronter aussi à la réalité et ce qu’elle contient de moins séduisant : Où donc résident les jardins voués aux fleurs, à leur plénitude, à leur fragilité […]. / Je perçois d’intenses cruautés, je vois de lointaines barrières, les portes de l’ombre s’ouvrent sur des forêts meurtries, des maisons éventrées, des jardins où ne s’ébroue plus la lumière, où ce qui se déclarait humain n’est plus que le mortel frisson d’un temps sacrifié, mutilé, sans oiseaux, sans arbre devant lequel se prosterner, sans rive où la mer s’ouvrirait comme des lèvres d’enfant dont le visage éclairerait tout ce qui vient à nous pour croître dans l’incessante fertilité de l’amour.
Mais Richard Rognet est avant tout un poète de l’inquiétude et du questionnement existentiel. Il est de ces poètes à qui la lumière n’est pas spontanément donnée, mais qui doivent se battre pour la trouver, en jouir un fugace instant, avant qu’elle leur échappe à nouveau… Vivre est pour lui, ainsi qu’il nous le dit, dans la quatrième de couverture, « Toujours ce même combat au cœur des ténèbres. Pas de pitié, pas de gratitude, pas de consolation ». Toujours sur la crête de ces instants qui volent en éclats, l’aventure de vivre nous serait cette épreuve « où aucun de nos gestes n’a su prendre le temps de s’allier aux mouvements si purs des plantes, des herbes, des fleurs ». Fluide, feutrée, exempte de trop vives aspérités, sa poésie, creusant son lit entre abandon et veille, nourrie de réflexions sur nos précaires existences, le temps qui passe, la douleur, la mort, est celle d’un rêveur solitaire aux yeux écarquillés sur le temps qu’il traverse, d’un promeneur qui s’achemine, dans l’espace du monde et celui, intérieur, de lui-même, à travers les méandres insoucieux des saisons et des jours automnaux qui descendent vers les ténèbres, affrontant patiemment sous de sombres nuages cette énigme insoluble qu’est l’existence, mais portant à dos d’homme, sans désespoir pourtant, cette « obscurité maladive » dont souffrent nos paroles. Ainsi, peut-il écrire, je suis l’homme de passage, le fragile chemineau qui ne sut jamais où ses pas le menaient, le visiteur consterné devant des portes muettes qu’il n’osa pas ouvrir. Ou encore, plus loin : Je ne suis qu’une rencontre confuse, un sang desséché sur des pentes invisibles, qu’un tremblement sur des mains enfantines, je ne suis qu’une barque égarée sur des eaux lointaines, une espèce de forme qui n’est rien d’autre que ce qu’elle aurait voulu partager avec une autre force qui s’est dérobée ou éteinte.
Si le récit est le lieu par excellence de la mémoire, si raconter c’est toujours vouloir d’une certaine manière conserver, maintenir intact, si on y bâtit des palais chimériques, en revanche les poèmes de Richard Rognet, où l’on décèle quelquefois une tentation narrative, s’avancent sur les ruines d’un impossible récit. Ruines d’une existence questionneuse dont il ne reste que des bribes, des braises sous la cendre. Et qui perdurent. Car les poèmes sont les fictions de l’oubli. Ils se déploient autour d’un trou, d’un centre qui manque. Ou n’apparaît que pour se dérober, ou pour nous y faire tomber en partie. Un oubli. C’est dans les creux de cet oubli, d’où fusent les réminiscences, que Richard Rognet s’efforce de « dire », en ces blocs rythmiques de phrases (semées d’alexandrins), dont il n’importe plus de savoir si ce sont là des vers, des versets ou des proses. Mais qui sont le théâtre de ces présences (comme celles des disparus) que la nuit lui révèle et fait rougeoyer, et c’est alors l’absence de ce qui est absent qui se lève et se montre : J’entends la nuit passer sur le chemin du vent. Qui suis-je pour saisir un semblable secret ? qui suis-je pour ainsi interroger ma mémoire et mes songes où s’empilent les vies de ceux qui m’ont quitté ? […] qui suis-je pour ainsi me confondre avec ce qui remonte des creux de mon passé, et qui ne saura point délivrer le présent où je piétine, comme une sève malheureuse qui ne parviendrait plus à grimper dans les arbres ? Cette clarté sans repos est celle qui préside aux errances dans le labyrinthe, aux longs des lignes brisées de son tracé, de ses pièces et galeries. Là, dérive la mémoire, détachée de tout ancrage, de toute mémoire ordonnée, là où brûlent les pertes. Là où le sujet qui s’y aventure se perd dans les fils de la mémoire devenue épervier d’oubli. Non d’un oubli pur et simple, mais d’un oubli en acte, pensée qui se sait désarticulée, qui comprend qu’elle erre dans un labyrinthe, impuissante à rétablir les liens entre les pièces qui s’ouvrent, à raccorder les corridors entre eux. Dans les pages de cette clarté sans repos, Richard Rognet sait faire parler l’oubli sans avoir pourtant prise sur le secret. Perdu désormais : A force d’hésiter devant mon propre seuil, de vibrer contre les murs avec les ombres échappées de mon corps, à force d’être en même temps le dedans et le dehors, la plainte et le silence, et le silence sous une autre plainte, sous le silence un autre silence, sans que je puisse trouver le fil qui déroulerait la pelote embrouillée de mes traces, sans que, de la lucarne qui limite ma vue sur le monde, je puisse retenir, au plus profond de mon désir d’être moi sans moi, l’espoir d’un calme parfait…
Mais dans ces poèmes, troués d’éclats de lumière, comme cette lumière infinie qui repose sur tout et sur rien, la lumière engagée dans l’épaisseur des mondes qui jaillissent en nous, se pose malgré tout quelque chose qui nous console, qui tient à la beauté du chant, à ce qu’il parvient à reconquérir de couleur de la vie et du temps, et de ces lointains sans arrêt espérés qui ne renient jamais la joie de patienter sous les nuages.
Michel Diaz, 26/04/2024