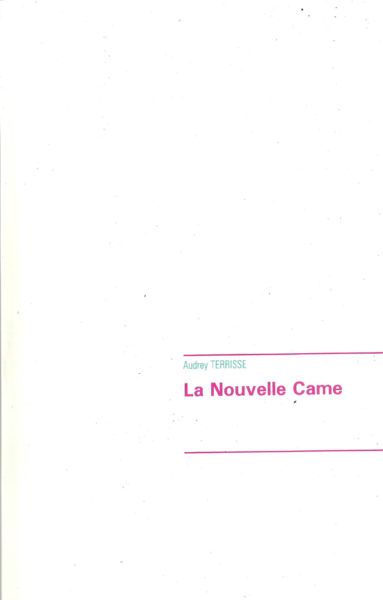LA NOUVELLE CAME – Audrey Terrisse – Editions BoD
84 pages
« Ma tête est pleine de trous. Tant d’abus. De maltraitances. Pas facile de mettre tout bout à bout. Les sensations demeurent. Instinctives. Longtemps je les ai fuies. Je les accepte désormais. Attraction répulsion. Une seule âme. Deux êtres en perdition. Deux corps en oubli. Sans reddition. J’ai soldé mes terreurs. J’ai liquidé leurs dettes. L’errance était insupportable. Cheminement vers la destruction. Puis un regard, une délivrance. »
C’est ainsi que commence le livre d’Audrey Terrisse. Par ce télégramme aux formules qui se bousculent dans un bref effort de bilan, et adressé d’abord à elle-même.
Chaque livre propose ses lois. En voilà un qui ne saurait se satisfaire, pour être lu, du silence des yeux, mais réclame d’emblée à être mastiqué, phrase après phrase, dans la cavité de la bouche, remué sur la langue, proféré à voix sourde entre des dents à peine décoincées, et trituré au bord des lèvres, avec le mouvement que l’on fait quelquefois quand on les débarrasse d’une trace de nourriture ou d’un brin de tabac, ou qu’on se prépare à l’injure.
Phrases lâchées par pulsations, comme le sang jaillit de l’artère tranchée, mots qui imposent leurs saccades, souffle court, cœur battant son tempo déréglé, percussion haletante d’une parole qui a ouvert ses vannes pour se libérer de son poids de souffrance, ou du vomi de sa mémoire.
Car ce livre n’est que l’évocation d’une intime souffrance et exercice d’exorcisme pour finir de s’en détacher, la tenir à distance d’un esprit et d’un corps qui en portent les cicatrices, marques indélébiles d’un ravage dont on ne revient que comme on a, au bout du compte, survécu à ce et ceux qui ont manqué de vous détruire.
Ne connaissant pas l’auteure de ce livre, j’ignore si ce qu’elle y raconte est authentiquement vrai (aucun pacte avec le lecteur ne nous le garantit), ou quelle y est la part de réinterprétation de la réalité, voire celle de l’invention et de la pure fiction littéraire. Mais acceptons-le comme un témoignage de vie.
Par bribes, quelquefois très brèves, dont il nous faut reconstituer la chronologie (un peu labyrinthique et quelquefois confuse) et identifier les protagonistes (il arrive que l’on s’y perde), nous est livré en vrac, à l’état brut, sous forme d’un texte en puzzle, à l’écriture hachée, le parcours d’une vie qui commence dans le confort d’une famille riche, installée dans les beaux quartiers du XVIème, à Paris. « Je suis née sous le signe du mensonge », écrit l’auteure, « je n’ai jamais réussi à démêler les nœuds des histoires qu’on m’a racontées ». Nous avons là, au grand complet, ou presque, les ingrédients de ce qui va conduire cette enfant « mal née » (?) à s’enfoncer dans le mal être de la solitude et la détresse d’une enfance « gâtée » par les carences d’une éducation que l’argent ne peut remplacer, puis dans la délinquance d’une adolescence « dorée ». « Les gosses de riches sont protégés. Mais pas des drames intimes. Tortures psychologiques, coups de ceinture, viols, abandons affectifs, nuits de défonce. » Ici, c’est un autre angle du même paysage : famille mal recomposée, père flambeur, coureur de femmes et collectionneur d’aventures, séducteur jamais rassasié, paternellement déficient ; mère belle, coquette et frivole (« on dit alcoolique mondaine ou dépressive dans le beau monde »), amatrice de jolies robes et de jeunes amants, qui ne se résigne pas à vieillir, veut faire de sa fille (dont elle s’occupe des toilettes mais jamais de l’état de son âme), l’image d’elle-même, c’est-à-dire quelqu’un de vain et de superficiel.
Après une enfance privée de vrais repères et dans un demi-abandon affectif, à peine compensé par les attentions de braves nounous, l’adolescence sombre vite dans les remous de la désespérance et de la dépression, avec les conséquences que l’on imagine : les bouées de sauvetage des premières amours, les relations au sexe compliquées, sans désir véritable et souvent nauséeuses, la déscolarisation, les médicaments, l’alcool, la drogue et les addictions à tout ce qui peut sauver de la réalité. « Addictions, alcoolisme, toxicomanie », écrit encore Audrey Terrisse, « je suis accro. A la clope, à la coke, aux médocs, au sexe, au coca light, au boulot. Je cultive mes addictions sans préférence. […] Manque permanent. Cruel. Nausées. Tremblements. » On n’échappe pas non plus, dans cet inventaire, à l’anorexie, aux images d’un corps qui s’abandonne au dépérissement, voit saillir en lui le squelette. « Géométrie à squelette variable. Je compte les os. Cheveux qui tombent. Aménorrhée. Cerveau qui pompe. Endorphines… Dysmorphophobie… »
Quelqu’un se noie ici, que l’on voit se débattre sans pouvoir lui porter secours, et ce petit livre nous ouvre, en quelques brèves pages, sur ce qui se passe dans l’intimité de ces familles qui, malgré leur appartenance à ce « beau monde », à ce que l’on appelle aussi « milieu favorisé », n’échappent pas aux catastrophes affectives ni à la misère relationnelle, ni au délit de maltraitance, et moins encore à l’hypocrisie des apparences que l’on se doit de cultiver, ni aux mensonges des adultères pratiqués comme « une manière de vivre ». Familles qui ne sont qu’un tissu de fautes morales, ces fautes dont André Breton disait qu’elles tachent l’esprit « d’un sang indélébile ».
Cet ouvrage contient, en ce qu’il nous raconte, qui n’est en rien pourtant de l’ordre de la « révélation », quelque chose qui nous touche, et souvent nous bouleverse. Ce parcours de vie que l’auteure nous livre, en salves spasmodiques, vient s’ajouter à la liste déjà longue d’autres terribles témoignages.
Il ne semble pourtant pas aller jusqu’au bout de son propos et a des airs d’inabouti. Ou, peut-être, est inaboutie la démarche de son auteure dans ses relations avec ses parents. Père et mère sont tels, décrits dans leurs travers et leurs insuffisances, et avec tout ce qui, à nos yeux, les condamne à être désignés comme pleinement responsables d’une lourde faute morale. Mais si l’auteure reconnaît cela, elle demeure cependant à leur égard dans une sorte d’acquittement (pour circonstances atténuantes ?) que l’on hésite à partager. Indulgence (ou faiblesse ?) qui semble même inacceptable au regard des ravages dont elle a été la victime. Des griefs, des reproches, certes, l’auteure nous en fait part, comme elle brosse aussi de ses parents des portraits peu avantageux et taillés au couteau, mais nulle vraie révolte en tout cela. Ni colère ni haine. Ni mouvement profond d’indignation. Ni véritable règlement de comptes. Tout cela dont on comprendrait la légitimité et qui remettrait en question notre attachement culturel à la sacro-sainte « cellule familiale », comme au « devoir d’amour » envers ses géniteurs. Ce récit apparaît plutôt comme un gémissement de douleur qui revêt quelquefois les aspects d’une plainte apitoyée sur elle-même. De plus, la victime semble, au fond d’elle-même, nourrir pour ses parents une manière d’indulgence que l’on peut, nous lecteurs, trouver loin de tout compte : « Mon père je l’aime. Loin. » Va pour le « loin », mais c’est bien peu payé pour ces années d’errance dans le vide où la vie s’engloutit. Quant à la mère, on devine qu’il reste envers elle, chez la narratrice, comme un zeste d’admiration, une sorte de compassion ironique à l’égard d’une enfant capricieuse qui n’a pas su grandir. Le cordon de l’amour filial ne semble pas vraiment coupé, quand on voudrait qu’il soit tranché d’un geste de scalpel. Et il en demeure un malaise, car notre empathie pour la narratrice se tisse au cours des pages.
Ce livre pourrait être, devrait être un coup de poing, un coup de pied rageur dans la fourmilière de ce « beau monde », et une assignation à comparaître devant les tribunaux de la morale, de l’attention et du respect que l’on se doit de cultiver pour l’Autre. Il ne lève jamais pourtant le poing de la colère ou de la révolte auxquelles on pourrait s’attendre, ne glisse vers aucun procès, sinon vers le portrait qui tourne en ridicule deux individus et se contente de se gausser d’eux en ricanant de leurs travers. L’indulgence, ou même le pardon, cela peut s’accorder, mais il faut tout d’abord aller au bout de sa colère. On veut bien croire de ce texte qu’il a servi à son auteure à se purger de ce qui demeurait en elle de souffrance, mais il n’ouvre pas une réflexion qui pourrait nous conduire à examiner le schéma de ce que l’on appelle aujourd’hui la « famille moderne », et à poser certains problèmes sociétaux dont il faudrait nous emparer. Car s’il se veut un « cri », il lui faudrait être plus efficace et sûrement plus radical. S’il ne se veut que « confession », il demeure trop sage à mon goût et il lui manque alors une dimension essentielle, celle de la contestation de ce qui n’apparaît ici, et dans un tel milieu, que dans l’ordre, scandaleux certes, mais presque trop banal des choses. Ces insuffisances, voire ces incohérences, peuvent aussi s’expliquer par le fait qu’il semble s’agir là d’un récit de vie largement fictionnel dont l’auteure n’a pas tout maîtrisé.
C’est dans cette perspective que, revenant sur son style, ce choix d’écriture qui d’abord nous saisit au cœur, on en vient à penser, dans les dernières pages, qu’il est une technique narrative dont les procédés, que l’on peut juger littérairement un peu trop faciles, finissent par s’user parce qu’ils ne trouvent pas tout à fait les moyens de servir avec plus de force la violence du récit.
Ces réserves faites, il n’en reste pas moins que ce premier texte publié ne manque pas de qualités et signale là une auteure qui ne manque pas non plus d’intérêt.
Michel Diaz.
Tours, le 24/10/2015