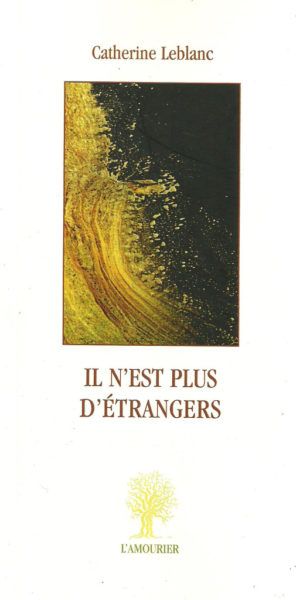 IL N’EST PLUS D’ETRANGERS – Catherine Leblanc, Editions L’Amourier (2015)
IL N’EST PLUS D’ETRANGERS – Catherine Leblanc, Editions L’Amourier (2015)
Chronique publiée sur le site des éditions L’Amourier, sur le blog de Catherine Leblanc, et dans le N° 37 de la revue L’Iresuthe.
« Elle est vieille et pliée, elle marche sur la route. Elle avance à petits pas, sur les lignes blanches, au milieu du tremblement des phares. Elle va vers le trottoir. Elle tient son sac, elle suit les lignes, ne ralentit pas, ne lève pas la tête, va vers le trottoir. Elle est noire. Elle traverse avec attention la minute qui passe. »
Ces quelques lignes, texte complet presque pris au hasard dans le petit ouvrage de Catherine Leblanc, Il n’est plus d’étrangers, suffisent à donner le ton et le style d’une écriture qui semble fonctionner « a minima », mais nous maintient toujours au bord de quelque chose qui provoque chez le lecteur comme un sentiment de léger vertige ou, pour reprendre un mot du texte précédemment cité, suscite en lui un « tremblement » de l’âme. Celui qui nous saisit quand, passant d’abord sans nous reconnaître dans l’angle d’un miroir, nous interrogeons une image que nous savons pourtant nous être familière.
Il y a quelques mois, sur une chaîne de radio, îlot sauvegardé de la parole « culturelle », dans une émission consacrée aux livres, j’entendais que l’on demandait à l’auteur invité (cela ne passait pas pour un reproche) pourquoi il ignorait les « grands problème sociétaux » et semblait délaisser les questions qui agitent le monde, puisque la fonction d’écrivain était aussi de rendre compte de l’état des consciences contemporaines, d’en enregistrer les secousses et d’en répertorier les maux. L’écrivain (peu importe son nom) se contenta de dire qu’il ne se sentait pas taillé pour assurer ce rôle dévolu aussi à la littérature, certes, et légitimement, depuis toujours, mais que son registre était autre et qu’il fallait laisser aux écrivains le soin d’aller creuser dans l’intime des êtres. Car, disait-il, la littérature était, selon lui, l’ultime espace de conscience où l’on pouvait aller au plus profond, au plus à-vif de nos interrogations sur nous-mêmes et au plus secret de nos sentiments. Qui peut faire cela, demandait-il à son intervieweur, mieux que les écrivains, artisans de « l’introspection » ? Savoir que dans le monde, il demeure un espace de subjectivité où l’homme peut se retrouver tout seul avec lui-même, confronté aux questions essentielles sur ce qui fonde notre condition, nos relations à l’Autre, c’est bien cela aussi qui pouvait justifier qu’on écrive des livres et que l’on défende la poésie. Car c’est là, disait-il encore en substance, que le langage, en touchant ces limites, se chargeait d’une effervescence qui proposait de la réalité du monde d’autres voies de lecture et d’autres pistes d’interprétation. Puisque aussi bien, comme l’écrit Catherine Leblanc, le « charme » du langage (dans le sens « magique » du terme) tient encore dans le « pouvoir des répétitions, des mélopées, du bercement de la langue. Tout le chant se révèle dans d’infinies variations de la voix ».
Les textes du recueil Il n’est plus d’étrangers, qui se saisissent de fragments de la réalité du monde, sont comme des croquis de notre immédiat quotidien, des éclats de conscience ou des tessons d’histoires, n’auraient pu être, sous une autre plume, que des photographies où l’anodin aurait fini par l’emporter. Mais la littérature est aussi cela, ce qui s’empare de l’intraduisible, ou de nos plus fragiles impressions, pour en faire matière d’écrit. « Les mots écrits expriment des choses qu’on n’aurait pas le temps de dire, pas la force de dire, des choses qui se forment lentement et qui se murmurent. Ce sont les paroles vraies qu’on va chercher dans l’ignorance. » L’auteure, par là, rejoint « la parole première » (titre qu’elle donne d’ailleurs à l’une des parties de son recueil) grâce à laquelle elle nous restitue ce que nous avions oublié de l’imaginaire de notre enfance.
En exploratrice avisée des formes littéraires, Catherine Leblanc se tient justement sur ces marges de la parole où les mots cessent d’être les outils de la communication sociale « efficace » (dans le sens technique du terme) et s’avancent dans l’embrasure de ce qui ouvre sur une autre lumière, sur un chemin de sens où c’est le cœur qui prend sur lui d’assumer les risques d’une parole dépouillée de tout artifice, et de tout appareil « critique ». Le risque, en premier lieu, d’une « nudité » stylistique où se joue cependant quelque chose de l’essentiel de notre relation au monde. Relation, ici, qui privilégie les êtres, humains ou animaux, et qui les donne à voir comme dans la nuit la lumière soudaine d’un flash surprend un geste ou un regard que dans « l’évidence » du jour on n’avait pas su voir. Que l’on voit pourtant, par exemple, dans le « ramassé » de ces lignes : « Il va seul, les mâchoires serrées. Il porte sa vie. Il la porte sur les pavés, le long des murs. Il la porte au fond des rues. Il la porte clandestinement, comme une grenade. » Ou dans celles-ci, où un « très vieux », à bout de vie, puise encore sa joie dans la contemplation d’un cerisier en fleurs : « Le vent léger emporte des poignées de pétales qu’il disperse. On dirait un lancer de confettis pour fêter de jeunes mariés. Un envol de fleurs blanches ou de plumes, une fraîche écume. Cela lui suffit. »
Catherine Leblanc se tient ainsi, sur la lisière du regard. Nous livre des « instantanés » de vie, des éclairs de mémoire, passages d’impressions fugaces « parfois trop ténues pour être retenues ». Elle n’écrit que dans les interstices du silence, que dans l’amitié de ces « presque riens », que sur ces fulgurances qui jaillissent dans les rencontres (dont beaucoup avec des enfants au psychisme abîmé), instants que l’on croyait perdus sous le battement des paupières ou les gravats du souvenir, ou refoulés à tout jamais dans les coulisses du non-dit. Et de ces intervalles de pénombre, moments de « clair-obscur » de la mémoire, elle fait émerger ce qui soudain se « révèle » comme un pan de l’infinité du réel, et où rien ne peut plus nous paraître ni purement anecdotique ni étrange, où en effet, non plus, quand nous considérons les autres sous l’angle de la seule « humanité, « il n’est plus d’étrangers ».
Je n’ai pu m’empêcher, pendant la lecture de cet ouvrage, de penser à Charles Baudelaire. Non à cause du style, mais à cause de la morphologie de certains textes et de certains aspects de la démarche littéraire et poétique de ces deux auteurs. L’admiration du poète pour Constantin Guys, peintre de la « modernité », croqueur de scènes de la vie, nous en apprend beaucoup sur ce qu’il voulait faire entrer dans le champ de la poésie. Et les textes qui composent Le Spleen de Paris sont de brèves nouvelles, inspirées d’un fait divers ou de choses vues, saynètes ou portraits dispersés dans une œuvre qui se voulait éclatée, disparate, et où chaque texte se suffirait à lui-même. On y voit Baudelaire déambuler dans l’espace urbain, en témoin curieux, perdu dans la foule et fasciné par le spectacle insolite de la rue qui s’insinue dans le quotidien familier, pour peu que l’on ouvre les yeux et sache regarder au-delà de la banalité des choses. Le pont jeté ainsi vers les textes de Catherine Leblanc ne semblera pas abusif si l’on se prend à les lire comme Baudelaire voyait les siens : une « prose musicale sans rythme et sans rime, assez simple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. »
C’est ainsi qu’il faut lire, je crois, les textes qui composent le recueil Il n’est plus d’étrangers. Pas seulement comme des miroirs où chacun de nous peut se reconnaître, mais comme autant de poèmes en prose qui s’inscrivent dans l’héritage d’une démarche littéraire que l’auteure prolonge de manière aussi personnelle que convaincante.
Michel Diaz – 23.12.15