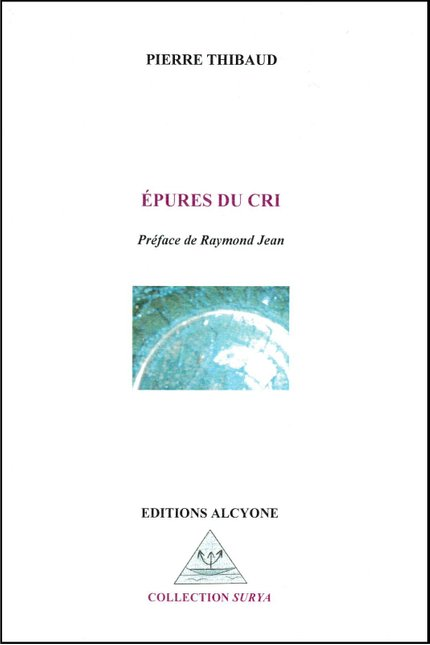
Epures du cri
Pierre Thibaud
Epures du cri
Editions Alcyone (2024)
Note de lecture publiée in Diérèse N° 91 (automne 2024)
Il y a un instant où le monde te creuse / un instant entre la vague et l’écume / entre voix et écho. Ce sont les premiers vers de la première section de ce recueil, intitulée Imminence. Cet instant est celui d’un suspens où Parfois le monde s’ouvre comme une mélodie / d’églantines, où Tout est déjà là / et pourtant à l’écart, instant où quelque chose veille qui ne s’est pas encore révélé, mais est sur le point de s’offrir, frémissement de l’aube, bond de l’insecte, course du vent. C’est ce que les mots du poète tentent de capturer, ce qui se tient aux limites du visible et de l’invisible pour devenir soudain / présence. Imminence contenue de la présence de « quelque chose qui veille », pour reprendre les termes de la préface de Raymond Jean que rappelle Pierre Thibaud
sur la quatrième de couverture, et qui réclame affût des sens, animalité et humanité au diapason de la précarité, le monde sensible étant alors perçu et restitué par petites touches, à petites gorgées, à l’entaille du poème, au contact de la terre, de l’air et de l’eau. Etat de fusion de vif à vif, non de confusion, où se fait chair le bruissement de la lumière / comme un long baiser / des lèvres du couchant. L’écriture se veut, sous la plume de Pierre Thibaud, à la fois quête et révélateur de l’être et du monde, cérémonial intime des sens en éveil. Mais l’accueil des sens n’est là ni béat ni passif. A la réalité furtive et insaisissable du monde font écho ce désir d’entrer dans le plain-pied des choses, ce sentiment de vivre dans les mots, au bout desquels le monde n’est pas en attente mais en suspens, comme feu en extase, feu qui, dans le poème, m’appelle / m’épelle, où le poète devient braise / projetant mille étoiles / à la face du temps. Elan de corps et d’être qui peut faire mal au dehors, brûler au-dedans, le poème est encore, par le corps du poète, lieu de passage / battu de vents contraires / cherchant chaleur et lumière, et réceptacle d’émotions, en éclats d’encre, égrenant le sens, exacerbant la sensibilité, entre onirisme et introspection, et jouant d’analogies insolites : tu voulais toucher / la grappe des sons sentir / le grain lissé par l’air. Les images se font, sous sa plume, découpage à vif et écheveau de sensations, ambivalence et ricochets de signes dans le blanc sans fond de la page : Toute une vie à questionner / la même terre / dans le silence qui brûle / le cœur // dans le fol espoir de retenir / la dernière aube / auprès / du lit.
Tu te succèdes / un et multiple / comme sur une note étale / la mer aux voix innombrables. Ce sont là les premiers vers de la seconde section du recueil, intitulée Nœuds. Et le poète ajoute un peu plus loin, dans le même poème : le monde s’écrit aux nœuds / où tu commences. Si nous sommes cet « un multiple » qui vibre de toutes les rumeurs du monde, mais où l’être parfois risque de perdre pied, il est possible cependant d’opérer une réconciliation de nous-mêmes aux nœuds de cette chair des choses, quand l’œil commence à regarder. Car regarder, ce n’est pas chercher à saisir, par tous ceux qu’à la fois nous sommes, la complexité de ce qui nous cerne, encore moins à posséder. Regarder, c’est plutôt consentir à être surpris, saisi en son être profond par cela même qui est insaisissable et celé dans les « nœuds » du réel, par ce qui apparaît, quand on laisse venir une de ces images qui nous touche et nous ramène à l’essentiel de ce que nous cherchons à être, à l’intime unité de notre regard, à cette note étale, comme ce soir d’été / (où) la peau nue de la lumière / se teinte d’ombre / et se vêt de silence, ou cet instant où l’on perçoit le tressaillement de la sève / et de l’écorce / sous la caresse du sang. Alors le regard s’ouvre jusqu’à accueillir l’intimité des êtres, et ce sera par exemple avec la fraîcheur qu’on sent exister au plus profond du ciel, pour un contact aussi fort qu’avec toute chose au monde que l’on touche, dont on sort éblouis / cœur en fête / corps apaisé. Comme il suffirait, écrit encore Pierre Thibaud, pour la mer / d’une goutte d’eau / pour la prairie / d’un brin d’herbe / pour que le ciel s’éclate à nouveau / et que l’éternité / s’ajuste à nos corps / comme un sourire à nos lèvres. Il nous faut alors obéir à l’extrême lenteur des choses / qui nous use jusqu’à la transparence / limant le chemin de nos veines / différant l’horizon / nous dispensant de mourir.
Vois ce sont là traces de guetteur / entre instant et mémoire // faille fil fragile / où l’immobile est frontière. Ce sont là, enfin, les premiers vers la troisième partie du recueil, Traces. Et Pierre Thibaud d’ajouter, quelques pages plus loin : Tout est écriture / et face à la fenêtre / tu lis à ciel ouvert / dans l’alphabet bleu / ponctué d’oiseaux. Approche-t-on là l’essence de l’émotion poétique ? Oui et non. Non, si nous pensons à la poésie comme à cette lutte amoureuse au sein de la langue contre ses propres pesanteurs, travail où la fraîcheur de l’émotion, liée au surgissement des premiers mots, risque toujours de se perdre, mais dont le poète sait pourtant mystérieusement raviver l’ardente lumière. Tu y apprends / la langue des oiseaux / pour mieux parler à toi-même, écrit le poète, qui nuance pourtant en écrivant, quelques pages plus loin : Natures à vif / qui me malmènent / faisant sans cesse échec / à mes mots, ou encore, je cherche un mot / qui devienne un poème / qui ne pourra s’éteindre. Oui, pourtant, si nous pensons à la poésie comme à ce qui vibre dans le monde, « autre monde » qui ne renvoie à aucun arrière-monde métaphysique mais qui est bien dans le monde, en-deçà tonal où l’on ne pénètre que par rencontre fortuite, sortilège du hasard. Est poète celui qui, selon les mots de René Char, « prend contact avec cette poésie dans un instant inévitable, au seuil d’une rencontre nécessaire, et si peu recherchée qu’il peut ne pas en ressentir sur le champ l’emprise ». Et c’est en terre d’oubli – notre mémoire – que se porte et se dépose l’appel, le ton des choses, comme ces graines que le vent emporte et oublie enfin quelque part, cet appel qui jette le poète dans « l’état d’émotion poétique » comme le disait Pierre Reverdy. Ainsi, Pierre Thibaud peut-il écrire : Il donne à la terre / la lumière de ses yeux // elle lui offre en retour / les mots enfouis / aux veines secrètes. Ou encore : Je naîtrai / de mes mots de sang // ferai crépiter ce qui ne parle plus / dans l’image plus forte que le feu, et dans les dernières pages du recueil, Des voix multiples / chantent en moi / parsemant la basse continue / d’étranges notes de passage.
D’étranges notes déposées sur la page dont le lecteur-passant s’étonnera peut-être, reconnaîtra et fera siennes, contrariant de la sorte la réflexion quelque peu résignée du poète, à la fin de l’ouvrage, à mettre sur le compte de l’humilité nécessaire à tout acte de création : Ephémère l’empreinte / laissée de mon passage // mes mots s’effacent / sous les coups de gomme / de mes rêves. Réflexion complétée par les derniers mots du recueil : En ce temps-là tu vivais / de métaphores comme miroirs / où le monde engrangeait ses reflets. Mais, ajoute le poète, la dernière métaphore s’ouvrira / dans une terre craquelée / fouaillée / par les gestes lents du vent. Et cela justifie ce qu’écrit Raymond Jean dans sa préface au recueil : « Quelque chose tremble ici sans cesse entre la peinture et l’écriture. Une voix particulièrement discrète et juste ». Une voix que les gestes du vent ne devraient pas se hâter d’effacer, n’en laissant que la trace.
Michel Diaz, 06/06/2024