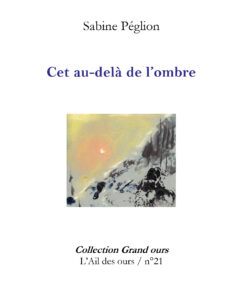
Cet au-delà de l’ombre
Sabine Peglion
Editions L’Ail des ours, Collection Grand ours (2023)
Note de lecture publiée in Diérèse N° 90 (été 2024)
Le titre de ce recueil, si on le lit un peu trop vite, comme les mentions « in mémoriam » figurant en italiques en tête ou en fin de trois de ces poèmes, nous feraient a priori penser qu’il s’agit d’un texte de deuil. Il n’en est pas exactement ainsi, s’il nous faut donner à ce mot une acception plus positive, à savoir celle d’un travail de mémoire associé à la volonté de rendre plus poreuses les frontières entre vie et mort. Ou présence et absence, ici et ailleurs. Comme sont tout aussi poreuses dans ces textes, celles qui séparent l’anonyme « toi » du « on » ou « nous », ou de cet implicite « moi » qui porte la parole que l’auteure s’adresse à elle-même : Ouvre la porte // ce soir // la mer délie la nuit // Regarde au-dessus des vagues / une lueur fragile / étincelles de vent / mêlées d’écume / brise l’opacité nocturne.
Quelques-un(e)s de ces disparu(e)s ne sont ici évoqué(e)s qu’à travers le « tu », le « vous » ou par leurs seules initiales, « B.B, S.J. », « M. B », quand une seule d’entre eux apparaît sous son nom complet, Bang Hai Ja, celui de cette peintre, poète et calligraphe sud-coréenne, morte en 2022 à Aubenas. Mais c’est dans cet « au-delà de l’ombre », dans ce que l’on arrive à voir « par-dessus les vagues », que tout se joue, que la lumière se reforme et que le jour se réajuste : Est-ce dans ce murmure / d’étincelles / éclaboussant la pierre / que renaîtra ton sourire / l’éclat de ta voix.
Rien n’est plus discutable, nous semble-t-il, que cette expression usuellement utilisée aujourd’hui, « faire son deuil », bien trop souvent réduite à son sens familier (« se résigner à être privé de … »), quand il s’agit plutôt d’un processus actif dans lequel la personne se met en action pour se délivrer de sa tristesse, peine, souffrance, incompréhension… qu’implique la perte, et renouer avec la vie. Ainsi, Sabine Péglion peut-elle écrire : On ne sait pas pourquoi / un jour / on recommence // Peut-être l’éclat du ciel / un peu plus bleu // On hésite à reprendre / On essaie on doute encore.
Mais s’il faut, tant bien que mal, retrouver le cours de sa vie, il faut aussi, pour la poursuivre sans l’amputer de l’une de ses dimensions essentielles, cohabiter avec la présence des morts, comprendre ce que cette présence apporte à nos existences. Car il y a, dans toutes les cultures humaines, obligation de composer non seulement avec la mort, mais avec les morts, avec les personnes disparues, et de permettre leur continuation, ne serait-ce qu’à travers les signes que le monde semble nous adresser : Toi l’ami // peut-être / là où les sommets se dispersent / où la roche seule / défie la neige et le vent. Car comment faut-il penser la présence des disparus ? Cette présence-absence qui fait que la notion de fantôme, le spectre, nous hante d’une manière si profonde qu’elle traverse toutes les dimensions du présent : De la terre monte / un assourdissant concert // Humilité recueillie / où tu t’inscris.
Pour ajouter quelques autres éléments à la démarche de l’auteure, nous évoquerons ici le philosophe Jacques Derrida qui fut, dans la dernière période de sa pensée, hanté par la question du spectre (idées politiques, actes du passé, personnes disparues) et des fantômes. Car au cœur de sa réflexion, et de plus en plus affirmée, on trouve la critique de la présence, comme modalité essentielle, immuable, opposée au néant. Et Derrida affirme que la présence n’est jamais entière, mais temporelle, différée, et hantée par la différence.
Il n’y aurait donc pas, selon le philosophe, de présence parfaite, absolue : ce ne serait qu’une une illusion métaphysique… Mais s’il n’y a pas de présence totale, alors peut-être n’y a-t-il pas non plus d’absence totale, et la disparition absolue ne serait rien qu’un mythe. Il n’y a jamais rien alors qui ne disparaisse totalement. Tout laisse une trace infime, même les actes les plus lointains des humains. La disparition et la destruction totale sont heureusement impossibles. Et Sabine Péglion semble presque illustrer ces propositions quand elle écrit : Tu n’as pas besoin de mots // Ecoute ce qui s’élève / puisé à l’origine du temps // ce bruissement léger / labyrinthe d’espoir // déposé sur la pierre / dilué dans la pierre.
Et cela justifie le fait qu’aller chercher les fantômes, convoquer les spectres, les rappeler à nous, ces êtres qui nous hantent pour nous soutenir, reconnaître ce qui vaut pour le présent et ce qui n’a pas encore entièrement disparu, est aussi une tâche humaine, une tâche présente, et parfois une tâche d’avenir. Une tâche qui, non seulement nous rend la mort moins hostile et moins repoussante, mais nous réconcilie avec les temps du monde : Quelque chose / nous appelle nous retient / une ouverture // Mais vers quoi / Vers quel lieu vers quel instant / vers quelle autre lumière.
Ainsi, dans ce recueil de Sabine Péglion, le rapport aux fantômes n’est pas seulement une démarche poétique pour apprivoiser la mort, ni une manière de rendre hommage à ces cher(e)s disparu(e)s qui hantent son esprit, mais un livre qui nous rappelle qu’il y a des spectres qui peuvent nous porter, des fantômes avec lesquels nous sommes familiers, des présences qu’il faut continuer, des vies qu’il faut poursuivre et qui peuvent donner à la nôtre une plus grande intensité, car ignorant les blessures / surgissent des failles obscures / les rayons d’un soleil foudroyé. Et nous nous en voudrions de ne pas citer les derniers vers de ce recueil : Si le cri de la mouette / déchire le silence // ne retenir des heures / que cette incandescence.
Michel Diaz, 03/02/2024