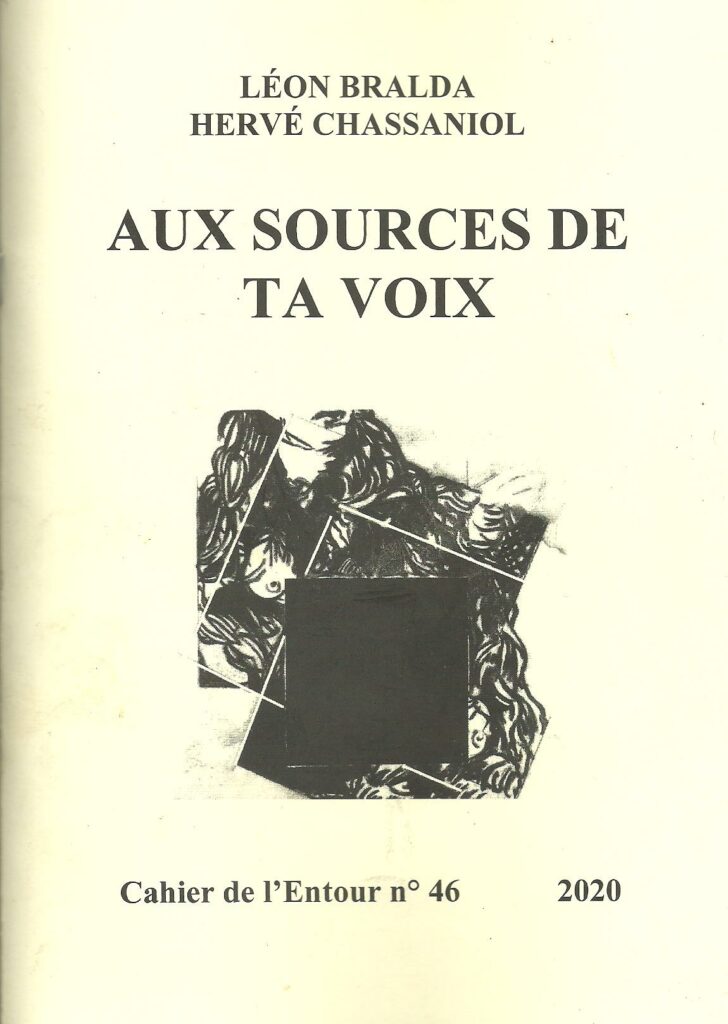
AUX SOURCES DE TA VOIX
Léon Bralda, Hervé Chassaniol
N° 46 des Cahiers de l’Entour (2020)
Chronique publiée dans Diérèse N° 79, été-automne 2020
Dans cette publication récente des Cahiers de l’Entour, les textes de Léon Bralda et les peintures, images déconstruites de Hervé Chassaniol, trouvent à dialoguer sur le même registre, celui d’une voix grave qui ouvre, en ombres d’encre, des espaces indéfinis où circulent, dans l’intimité de leurs traces, d’insolites tombées de lumière.
Dans la poésie de L. Bralda, celui qui parle et qui, comme à l’aveugle, avance tâtonnant, sur sa ligne de crête, de mot en mot tracée, sinueuse, hasardeuse (mais la seule qu’il puisse suivre), se tient toujours, en équilibre, semble-t-il, entre la veille et le sommeil : Le poète a marché sur des chemins de pluie, écrit-il, et conservé la nuit du côté de l’orage. Seule son âme fouille dans le tourment de l’eau. Et quelques pages avant on lit aussi: Et c’est de là, tu sais, que vient toute parole renversée sur son centre, de là qu’elle ouvre à sa naissance perpétuellement.
Avancée à l’aveugle, entre veille et sommeil, en territoires d’ombre, changeants et indécis, hantés de voix et de présences, mais avancée sur des chemins qui repoussent toujours plus loin ce que le regard, un instant, a cru pouvoir saisir. C’est bien cela qu’Eric Barbier traduit dans son Editorial (Diérèse N° 74) : « La poésie pourrait être une histoire de retour, le chant de ce voyage vers un point d’un territoire que nul ne saurait cartographier. Là, nous ne devinerons ni qui ni quoi devrait nous attendre ». Et il ajoute : « La poésie voudrait rendre tangible notre présence au monde, autre parmi les autres ». Présence au monde que, pour rendre tangible, le poème s’efforce de traduire en mots. Des mots, semble lui répondre Claude Albarède, qui sont comme des « pierres mordues / jusqu’à parfois / la source absente » ou « comme un cri / forçant la pulpe / d’un fruit mordu / jusqu’à plus soif ». Ainsi comprenons-nous ces mots de L. Bralda : Qu’il brille sous le renversement des roches, ce fruit revenu à sa pleine mesure. Que se fasse à nos lèvres le corps étrange de leurs silences noirs. Et ceux-là encore : Et toi, gardien de phare antique, éclusier des saisons, tu sens poindre un orage ailleurs qu’à l’horizon. (…) tes veines coulent d’un sang brûlant. C’est ta soif qui tarit sa coupe de fontaine…
Passant perpétuel est donc celui qui va, en ces territoires d’incertitude, avançant sous l’immense égouttoir d’une aurore prochaine, avec le dieu sur les épaules comme une neige aveugle. Passant qui pousse devant lui ses portes de pénombre, mais « passeur » aussi bien de ce que les images, ces pierres vives débusquées aux racines de la parole, sont capables de délivrer de battement secret qui cogne au pouls du monde, cette sourde accordance qui fait battre ton cœur inexorablement. Pouls têtu que la poésie sait entendre et capter pour le faire sien, drainant toujours jusqu’à l’aube des temps le vivre et la parole. Car c’est ta soif qui jaillit aux sources de ta voix.
Les « sources de (la) voix » sont celles où le poète puise la matière de son poème. Sources obscures comme le sont celles dont la résurgence nous relie aux ombres de l’absence et à la présence des morts. Ce qui s’installe ici efface la nuit et l’appelle d’un même mouvement, nuit qui gagne sur la parole à mesure qu’elle la dissipe, qui renâcle et s’ébroue, mais s’effondre d’un coup, ici, où l’on sent, qui montent en silence, des bruits très anciens, et que le temps se lève et respire, un peu : Vis ! Pour qu’à travers cet éphémère instant, nous puissions recueillir la sève immaculée des tilleuls et des menthes, à la tombée du jour, quand nos aïeux veillaient. Ces textes sont peuplés de présences tutélaires, qui servent d’intermédiaires entre nous et le monde, entre nous et les autres ou entre diverses parts de nous-mêmes : Quand affluent les figures à la croisée des mots, ce ne sont plus les drames qu’encorde une ridée mais un miracle d’homme à des matins amalgamés. Une image surgit, traverse le regard, agite dans le fond de la mémoire les strates cumulées du temps, heurte d’autres images, les brise, s’y mêle, la nuit s’efface, apparaissent alors des silhouettes de point de jour. Ainsi, cette figure, comme une apparition spectrale (qui pourrait nous faire penser à celle d’Ophélie dans les textes que Michel Passelergue lui a consacrés) : Une fille est passée du côté des orages. Elle portait l’ombre et la mélancolie. Elle faisait surgir sur le chemin qui l’accompagne toute une enfance morte et des songes de vieille dame ». Ainsi encore ces figures : Nous rassemblons dans le sommeil les portraits de nos mères. Nous aimons, à l’heure de leur mort l’indifférence coupable des lauriers et des joncs.
La conscience de notre-être-au-monde, telle qu’elle apparaît dans la poésie de L. Bralda, n’est pas celle que le discours philosophique nous invite à rassembler pour l’éclaircir et l’unifier, sur laquelle il nous faut travailler pour la combler dans l’épanouissement de ses limites et en faire un «tout» rond, unique et homogène. Mais elle est celle d’un total et inguérissable dépaysement, une volontaire « désappréhension » de soi-même, dans un espace où sont poreuses les frontières entre ici et ailleurs, entre maintenant et les couches de temps accumulées dans nos mémoires, ou encore entre « moi » et tous les « autres » dont nous sommes faits, car vivant tu retournes à l’heure de tes morts ! Puisqu’il faut vivre sans te défaire du marbre qui t’habite, que tu devines déjà se stratifiant en toi, puisque le poète ne peut prendre racine qu’au-dessous de (nos) peurs.
Citons encore E. Barbier qui écrivait dans le même éditorial : « La poésie représenterait une manière de se tenir en un bref écart de ce même monde, comme pour mieux en percevoir tous les possibles ». Situation inconfortable aux yeux de qui se sent incapable de l’assumer, car le ciel du poète est un fardeau qui pèse sur (ses) épaules et fait courber le dos. Mais celui-ci sait aussi mesurer le prix de son cheminement sur des sentiers d’obscur puisque ce ciel, comme l’écrit L. Bralda, se penche parfois jusqu’à nous et approche (nos) yeux comme un soleil de plein amour.
Michel Diaz, 26/01/2020