MICHEL DIAZ, Quelque part la lumière pleut, Éditions Alcyone
Recension du recueil publié in Trames nomades, mai 2022
tu savais que le temps se cachait dans le battement de tes cils, mais ne pouvais que demeurer ainsi, et enclos en toi-même, comme un arbre veillant le silence de ses blessures
Michel Diaz, Quelque part la lumière pleut, p. 13 (le titre vient d’un poème de Silvaine Arabo)
on n’écrit rien avec le rien, même en lisant dans son miroir ce vide qui s’étonne, ni rien non plus avec ce qui s’épuise à lutter contre l’ombre
Quelque part la lumière pleut, p. 25
mais surtout j’écoute le vent, j’écoute les murs, j’écoute les âmes
Quelque part la lumière pleut, p. 71
Je regarde d’abord l’encre de Silvaine Arabo qui introduit le livre (juste après un texte avant-signe). Je la regarde avec la même liberté intérieure que celle que j’ai devant les affiches déchirées que je cherche dans le métro, en capturant du regard des fragments pour recréer un autre imaginaire que peut-être personne n’aurait vu. Évidemment, là, nulle affiche déchirée, mais une création pensée, structurée, de l’art.
Cependant je sens que je réinvente peut-être l’œuvre (après tout c’est ce que l’œuvre veut aussi, toujours).
Ivresse des vents, est le titre de l’encre. Et voilà, avant d’être un lieu du livre de Michel Diaz, ce qui prolonge ma lecture de Capter l’indicible de Silvaine Arabo, livre où l’air et le vent font l’épure du réel. Mais dans ce livre de Michel Diaz, ouvert par cette image, dans les dernières pages surtout, celles de l’espoir, épure par l’air et le vent, aussi. Parenté d’univers dans l’exigence du regard et de l’écriture. Pas étonnant que ce livre de l’un soit dédié à l’autre. Par la dédicace, par le titre, par un exergue, par la citation finale et bien sûr avec cette encre.
Alors je regarde encore et reviennent deux vers de Silvaine Arabo… (Capter l’indicible).
Ultime salut au vent
Et à l’oiseau.
Et des mots de son livre, encore. Jubilation, vertige.
Puis deux autres vers d’elle, même recueil…
Ce grand océan cosmique
Qui nous interpelle sans cesse…
Toujours dans la présence de l’encre qui offre des clés pour lire ensuite au plus juste les pages qui viennent.
C’est cela que je vois dans l’encre, pas étonnée qu’elle soit là. Car l’Ulysse de Michel Diaz était déjà ce voyageur cosmique, dans l’abîme d’une profondeur, interrogeant le destin, les choix, et la bascule toujours possible vers un renoncement, un néant, ou au contraire l’ancrage d’être, démarche métaphysique au-delà des temps (Le verger abandonné, recension à lire ici, lien en fin de note).
Dans l’encre, serait-ce Ulysse, ce personnage dont l’ombre contemple un gouffre bleu, près d’une sorte de fleur verte géante ? Gouffre de l’infini, car le bleu est sa couleur. Ombres séparées, deux silhouettes sombres, sur une rive ou un bateau, sous un fragment de ciel mauve et un envol d’oiseaux. La solitude des êtres dans les lieux vidés de vie. Mais ayant lu le livre qui suit, je vois aussi la barque de Charon dressé devant l’âme d’un mort et traversant le Styx avec lui. Alors Ulysse est aussi l’auteur écrivant pendant l’hiver du confinement, entendant la litanie quotidienne des morts, et qui évoque les fantômes des êtres perdus, ces inconnus, mais aussi les deuils personnels, ces présences-absences dans une maison. Comment penser nos vies sans penser la mort ? Et comment penser le monde tel qu’il est sans penser ce qu’il fait de la mort ? Cela est dans l’encre comme je la perçois, assez riche pour porter tout l’univers des pages de Michel Diaz en même temps que toutes les méditations de Silvaine Arabo.
Je ne peux qu’associer cette encre au logo de la couverture, belle conception de Silvaine Arabo, qui est la marque visuelle de l’édition Alcyone. J’y vois un infini, de la douceur.
Quelque part la lumière pleut. Magnifique titre, cet emprunt à la poésie de Silvaine Arabo. Thématique commune aux deux auteurs, la lumière. Croire qu’un sens peut émerger, que l’écriture peut faire advenir et transmettre. Ou que, quelque part, cela s’offre si on le déchiffre. La lumière c’est aussi celle qui sourd du mystère de la camera obscura de nos yeux, au profond du regard, et dans la tension entre écrire et être.
Mais un texte précède l’encre.
La première phrase offre les trois titres des parties du livre.
Dans l’incertain du monde
S’essayer à vivre plus loin
Travailler à l’offrande
Partir du constat, dire l’intention, agir pour un possible horizon.
Superbe texte, entre prose poétique et philosophie. Constat lucide concernant l’état du monde, et élan pour ne pas renoncer, éthique d’une présence agissante, par la conscience dans la création. Dans ce texte je trouve un souffle qui a la force de celui d’Albert Camus dans Noces ou L’Été. Et justement des refus similaires, la même ardeur vitale pour choisir de FAIRE, et un mot commun, qui vient de la même perception d’une nécessité, résister. Recoudre.
Michel Diaz veut (lui et nous, humains) qu’on travaille à recoudre les fêlures de l’âme, et, avec ce qui nous reste de raison… affronter le crépuscule des désastres à venir. Plutôt que d’accepter le désespoir (frôlé dans certains textes…) il choisit d’écrire que rien ne sera perdu dans l’éternité du silence, tant que (…). C’est donc notre choix….
Albert Camus, qui parle du malheur du siècle en refusant lui aussi le désespoir, veut qu’on sache sauver l’esprit, apaiser l’angoisse infinie des âmes libres. Et il écrit que Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste (…). (Les Amandiers, dans L’Été).
Recoudre. Cela signifie qu’on part de ce qui est, et qu’on fait lien. C’est tisser avec le réel, pas avec des projections mentales. Du concret. Chez les deux auteurs la nature, pour rappeler notre ancrage dans le présent matériel et le voisinage du vivant. Du réel. Camus insiste, au sujet des amandiers de son texte. Ce n’est pas là un symbole. Non, pas un symbole, des arbres vraiment. De même la mer présente dans les deux textes. Pour Albert Camus, c’est le vent qui vient d’elle. Pour Michel Diaz c’est, dans cette page, celle que va rejoindre une rivière. Lui aussi pourrait insister et rappeler que la nature dont il parle, si présente, n’est pas un symbole. Elle est le vrai chemin pour ses pas de marcheur, l’ombre vraie du soir avec ses odeurs et ses sons, l’herbe réelle, des arbres qu’on peut toucher, des pierres qu’on ramasse (il en posait, raconte-t-il, comptant des jours dans notre hiver confiné).
Ce texte d’avant-signe, qui préfigure la structure et la dynamique du livre entier, sera à lire et relire, pour qui veut saisir la densité de l’ensemble. Afin de s’en imprégner et d’en saisir la beauté. Il contient beaucoup, tant la perte que la joie, le temps, le silence, le visage et l’arbre. Et il inscrit une écriture qui n’appartient qu’à l’univers de Michel Diaz, une densité particulière, un rythme qui contient du silence, posé dans les virgules, dans les espaces entre les brefs paragraphes (pour le temps d’une respiration), et dans les mots qui donnent à voir, par touches légères (rose, mésanges, arbre…). Car le regard ne se trouve que dans l’immobilité du regard, même en marchant.
Chaque partie a ses exergues.
Silvaine Arabo pour la première. Cinq vers de Triptyque. Pour inscrire le même regard que celui de l’avant-signe, un constat, et le souffle portant au-delà des douleurs.
Ensuite c’est Léon Bralda, La voix levée (pour un rêve vers un ailleurs autre), et Paul Verlaine, Sagesse (L’espoir …).
Enfin, dernière partie, André Gide, Nouvelles nourritures (le don… l’offrande).
………………………………………..
Dans l’incertain du monde
On ouvre les pages et s’offrent encore des paragraphes brefs, sans majuscules ni points, seulement des virgules pour marquer les espaces intérieurs. Écriture du marcheur qui dessine un chemin, un long couloir de mots où je vois l’image du rouleau de Jack Kerouac (Sur la route), comme si l’horizon d’un voyageur et celui d’un marcheur pouvaient se figurer de la même manière. Mais j’ai en mémoire, aussi, de longs parchemins enroulés, portant des textes sacrés conservés dans des monastères lointains. L’écriture et sa part sacrée, avec ou sans dieux. L’absence des majuscules fait couler doucement un fleuve de phrases, sans angles.
La route de Kerouac c’est une errance, sacrée à sa façon. Celle de Michel Diaz c’est une déambulation, autant intérieure que de pas, un parcours libre avec, comme bagage, le regard, des questions, et, peut-être, carnet et crayon. Les questions, c’est justement ce dont l’auteur dit vouloir créer un nœud coulant qui fera du lecteur inconnu le passager d’un espace de silence de funambule, le réceptacle, en son corps, d’une cicatrice inversée, mémoire d’une brûlure. Ambition, pour l’écriture, d’un pouvoir qui est très loin de la fadeur mièvre. Une conception de ce que doit être la poésie, le contraire d’une jolie distraction. Conception active de la lecture, faite pour des mains tisonnières capables de chercher la lumière dans les traces du feu qui a brûlé les questions (et les réponses ?) par l’écriture. L’inconnu est aveugle, mais muet aussi. Car pour lire il faut se défaire de son propre regard et de ses propres mots, accepter l’effraction de pensée par les yeux et les mots d’un autre.
Et effectivement on voit, avec les yeux du poète, traçant un poème-prose, un paysage de feuilles, terre, ciel, et forêt, yeux grands ouverts qui sont les yeux de l’âme. On est dans un crépuscule d’ombres et étoiles, on entend les voix obscures devinées.
Écriture du temps du confinement, où la réalité extérieure reste cependant violemment présente, un monde toujours en guerre contre les vivants et contre la vie elle-même (…) peu d’horizon à cette absurde conjoncture qu’est le fait d’être né.
Il cite Samuel Beckett (… juste avancer) et Michèle Vaucelle (déglutir le monde). Alors il faut écrire, et ce monde le restituer dans le cri. Injonction intérieure, éthique affirmée. Exigence qui croise celle de Jean-Pierre Siméon (La poésie sauvera le monde), quand il définit la poésie comme un acte de conscience aigu en s’appuyant sur Roberto Juarroz, qu’il cite (la poésie… accélérateur de conscience). Ces deux mentions conviennent à la démarche de Michel Diaz, à la brûlure du poème vrai. Et de même ce que dit encore Jean-Pierre Siméon sur la poésie force d’objection empêchant de se détourner du réel tel qu’il est et tel que le livre la poésie. C’est cette vérité du langage qui ne ment pas que propose ce livre, tout en cheminant vers ce lieu où la lumière pleut.
Au bout du réel il y a la mort, celle que pense le guetteur crépusculaire qui écrit, et qui parle de nos peurs, et des impulsions de survie qu’on dresse comme des écrans.
Ce livre ouvre ses pages, et il renvoie à d’autres chants, tristes ou pas. Au-delà de toute mélancolie il ouvre d’autres livres et entre dans un concerto de poèmes. Pas n’importe lesquels, ceux qui contiennent le feu du duende (Lorca…). Ainsi, le lisant, j’entends, comme en surimpression, le Chant des âmes retrouvées, poème unique qui clôt le livre de François Cheng, ses récits de Quand reviennent les âmes errantes.
La mort a eu lieu ; la mort n’est plus, écrit François Cheng.
Et Michel Diaz poursuit sa méditation.
Il est celui qui penche son visage sur la mer (et nous aussi, lisant). Il regarde, écoute, accepte d’entendre les cris de peur, de douleur et de guerre, malgré le bruit des tumultes du monde, bruit qui les recouvre, masque. Sachant le silence il se lave et nous lave des bruits. Tension d’écriture, dire et les cris et le silence (celui qui permet d’atteindre le centre de la parole essentielle).
J’ai remarqué des reprises de mots sur une même page, toujours en tête des paragraphes.
Par exemple, tu et peut-être (p.11), deux fois chaque.
Et, page 17, répétition de celui qui penche son visage sur la mer, deux fois.
Prolongé, page 18, par trois paragraphes commençant par je l’eusse aimé (celui qui…).
Ou ce vent, page 28, deux fois. devant, p.31, trois fois.
la nuit, tu marches dans toi-même, p.39, deux fois.
tu vis, tout le long de deux pages plus un paragaphe,p.42-43. Anaphore…
Je pourrais donner deux ou trois autres exemples. Et le dernier, offrande, p.86.
L’effet est rythmique. Ces mots ou bribes de phrases sont comme le battement d’une basse dans une composition musicale, permettant ensuite comme un envol du souffle.
Je relis la page 18 et c’est tout son Ulysse que je retrouve, présence du personnage mythique tel que le voit Michel Diaz dans Le verger abandonné. Solitude libre qui assume tout de ses choix. Ulysse n’est pas nommé ici, pas évoqué. Mais son esprit hante cette page, à cause des étoiles, du corps ployé dans le vide, à cause des vagues, et de cet être, seul parmi les hommes (…) intraduisible et seul (…) unique survivant d’un impossible dire et d’une impensable pensée
Seul comme beaucoup dans ce temps de confinement.
Et s’il y a le matin, les collines, l’herbe, la terre, l’horizon est vide d’êtres…
Fracture bouleversante, le texte dédié à sa mère. En pleine période d’épidémie et d’enfermement, elle glisse dans l’oubli sans limite. Et il la voit se noyer au fond d’elle-même, puis se perdre, séparée. Texte fort, douleur nue. Là ne viennent pas des échos d’autres textes, ni de lui ni d’un autre. L’émotion surnage, pure, unique. On évoque plutôt des visages. Ce récit éclaire tout ce qui suit. Crépuscule, ciel, oiseau, réel. Même, ou surtout, cette urgence de l’âme dans l’instant mis à nu.
La mort est toujours présente, chaque soir, faucheuse sous forme du galop assourdi d’un cheval, qui peut figurer la litanie des chiffres.
Conscience du temps. Le passé et ses blessures, le futur et son incertitude. La nuit est une île pour le présent. Dans la conscience du perpétuel inaccomplissement d’être.
……………………………………….
S’essayer à vivre plus loin
ces temps qui nous gouvernent sont comme la misère
Première ligne de la première page de la seconde partie, celle d’une inquiétude dont la dimension est collective, sociale, politique presque.
En écho, une citation de Rilke (p.49).
une clarté crépusculaire est tombée sur le monde (Le livre de la pauvreté et de la mort).
Aux constats tristes opposer l’espoir de l’acte qui répond. Et c’est Patricia Castex Meunier qui sert d’appui à cette ouverture, avec son instinct du tournesol…
Demeure l’espoir, la nature, et les fulgurances de l’écriture.
Une autre citation, de Catherine Pozzi, accompagne son rappel de la lumière, de l’infini (l’âme est une eau heureuse où tremble l’univers).
retiens-toi de mourir, voici une autre basse rythmique et de sens pour d’autres pages, litanie d’espérance de celui qui sait avoir à accomplir et à marcher encore sur les chemins, regardant les arbres et les oiseaux.
mais surtout j’écoute le vent, j’écoute les murs, j’écoute les âmes
………………………………………
Travailler à l’offrande
Offrande… Qui offre ? Quelle offrande, de quoi ? D’abord c’est un accueil offert à ce don qu’est la nature, sa beauté, sa force. Le regard, une acceptation dans la présence à ce réel qui dépoussière l’être de ses inquiétudes, et même des racines des inquiétudes. Accepter l’offrande de ce qui est. S’offrir, soi, à ce qui est.
Et le don majeur, pour qui écrit, c’est le poème, cet acte du « faire », qui crée beauté et sens.
tendre vers (…) cela qui donne raison d’être à l’être.
L’offrande est tout cela, et l’ode au réel.
contre la nuit meurtrière qui pèse sur un monde où erre l’ombre de nos mains défaites
Opposer la présence à ce réel des choses du monde.
Et semer le germe du possible qui mène
quelque part
où la lumière pleut
Ainsi les dernières lignes du livre reprennent les mots du poème de Silvaine Arabo qui ont donné le titre. Structure ternaire des textes (comme trois marches vers un lieu), et structure en boucle qui dit une traversée, partant d’une intuition et d’un savoir (lumière, sens) à la conscience renforcée de cela, après un parcours où les obstacles et les doutes n’ont pas été occultés.
LIENS…
SITE de Michel Diaz… https://michel-diaz.com/
Page, éd. Alcyone (ses livres)… https://www.editionsalcyone.fr/441615234
Deux dernières recensions, ses livres, ici…
Le verger abandonné… http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2021/12/14/le…
Lignes de crête… http://tramesnomades.hautetfort.com/archive/2021/04/17/re…
recension © MC San Juan
Écrit par MCSJuan dans les catégories POÉSIE.poètes, RECENSIONS.livres.poésie.citations.©MC.SanJuan | Tags : michel diaz, quelque part la lumière pleut, éditions alcyone, alcyone, collection surya, surya, silvaine arabo, albert camus, jack kerouac, jean-pierre siméon, françois cheng, duende, lorca

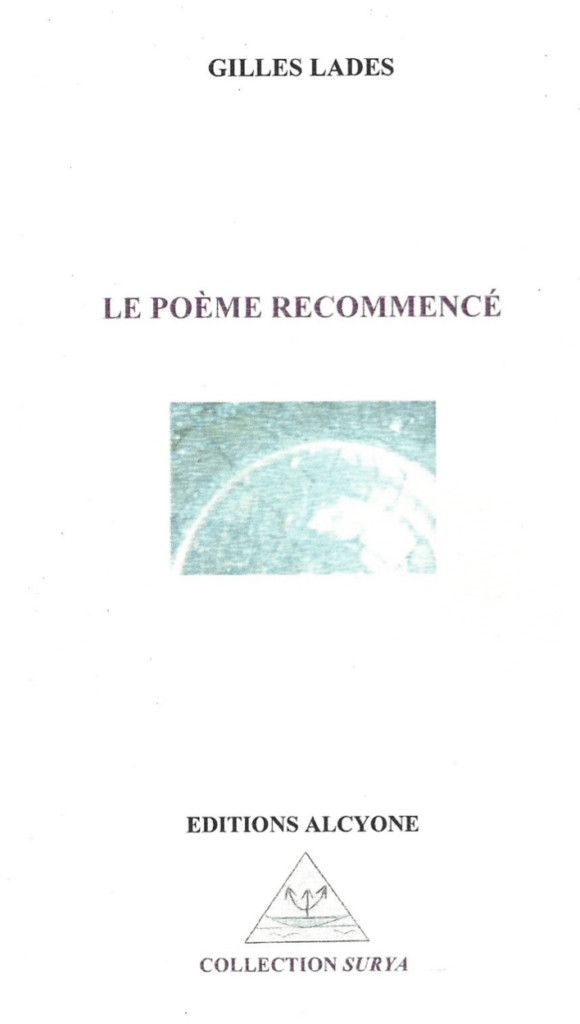 Le poème recommencé – Gilles Lades
Le poème recommencé – Gilles Lades