FÊLURE, lecture par Bernard Henninger. Article publié sur « Lire au centre », blog de FR3 Centre-Val de Loire.
Fêlure (Michel Diaz)
« fêlure »
Recueil de poèmes de Michel Diaz
aux éditions Musimot a la forme d’un livret carré, et il tient dans un sac ou une poche. Constitué de poèmes en prose, son style semble s’inspirer librement des Haïkus Japonais…

À la manière d’un journal, chaque poème débute avec une date, le recueil commence au 21 décembre et s’achève au 26 mars, et semble proposer un compte-rendu du temps qui passe… ce qu’il feint d’être avant de s’évader vers des dimensions plus intérieures. Le poème part d’une chose, d’un fait, d’une constatation de nos sens, pluie, froidure, chaussures mouillées suivi d’une plongée intérieure :
21 décembre : Ces longs flocons qui tombent, je suis seul à pouvoir les entendre… Comme je suis seul aussi à entendre ces lents éclairs, ces lentes minutes, ces lentes secondes, et ces toujours plus lourds et longs instant et ces patientes plantes qui descendent, l’une après l’autre les imperceptibles degrés du temps.
Et le lecteur pénètre au cœur d’un hiver qui n’est ni tout à fait une saison ni tout à fait un paysage de l’esprit, qui échange l’un avec l’autre dans une circulation fluide entre une réalité qui nous reste étrangère, muette, car fermée aux échanges, aux émotions et des paysages intérieurs déchirés. Par le biais d’une mise en abîme permanente, le quotidien et l’hiver permettent de découvrir les facettes d’une nostalgie :
Aux heures de lumière avare où le sang ralentit, où les mots se font rares, se cognent à leur ombre et ne font qu’une suite de râles, je déplie le rouleau de l’hiver.
Le travail de Michel Diaz témoigne d’une économie de moyens, d’une volonté de se restreindre à un vocabulaire concret, entre l’immédiateté du réel, les brisures d’une vie qui est comme un émiettement de l’être, et le rêve idéalisé d’une présence au monde exempte de douleur, d’émotion, comme si on pouvait être sans aimer et sans souffrir.

Partant d’un questionnement, chaque poème en prose débouche sur une absence, un manque que l’on questionne, il y a dans ces poèmes une épure et un élan qui font songer à la construction des Haïkus, écrits avec une une prose exigeante, qui, plutôt que de se soumettre aux conventions rebattues d’un sage déroulement des vers et de leur chant si conforme, tente de se confronter à l’âpreté de la prose.
10 janvier : On dépose bien ses chaussures mouillées sur le seuil de la porte. On peut y déposer aussi ce qui, de nous-mêmes, nous est un encombrant bagage. Ce qui tombe d’un mur mal bâti… Longtemps j’ai rêvé d’habiter un corps, douloureusement inconnu et toujours hors d’atteinte. Un corps étranger, mais jumeau, qui depuis toujours m’attendait, au revers de la porte close. Sans chagrin de sa part et sans rien à défendre…
Il y a des brisures d’enfances, jamais résolues, qui empoisonnent le regard, et ces fêlures me semblent entrer en résonnance avec une autre, plus ancienne mais qui chante dans la mémoire :
Le vase où meurt cette verveine
D’un coup d’éventail fut fêlé
Le coup dut effleurer à peine
Aucun bruit ne l’a révélé. […]
Mais la légère meurtrissure…
En a fait lentement le tour. […]
Toujours intact aux yeux du monde,
Il sent croître et pleurer tout bas
Sa blessure fine et profonde ;
Il est brisé, n’y touchez pas.
Et cette fêlure, cette perte d’innocence, conduit au mutisme, à l’impossibilité de dire ou aussi, parfois à une brisure du Soi, un dédoublement, où l’autre semble posséder une vie propre, une présence au monde calme, libérée de la douleur et de l’angoisse; Pourtant, la création avance au travers de l’hiver, égrénant les jours, peut-être plus optimiste qu’elle ne veut bien l’avouer : « ne pas se désoler, pensais-je encore, d’avoir autant lutté avec si faible esprit et de si pauvres armes », la poésie vue comme une issue, faible, ténue, parfois dérisoire, pour émerger du labyrinthe intérieur qui est comme un gouffre magnétique, qui attire plus qu’il n’effraie.
La poésie comme une magie : les mots sont comme les briques d’un jeu de construction, mais plus le texte progresse, plus le matériau se fait rare, ou plutôt se condense, réclamant en quelque sorte, une compensation à cette tension, et un poids équivalent de silence. Voilà, donc ce court recueil que l’on peut évoquer à défaut de l’analyser :
Flaques de mars, battues de vent, haleine, froid, mais sa présence insaisissable, à fleur d’épaule, une main presque amie, comme cherchant une clé.
La poésie de Michel Diaz mêle l’obscurité des mots, la clarté d’une froide saison, le désespoir d’écrire et ce sentiment de la vie comme une fêlure fine qui parcourant le vase de notre être menace de le scinder en deux.
Voici donc un recueil qui conjugue nos mots, et si cette chronique fort tardive parvient à vous donner le goût de l’hiver, n’hésitez pas à vous plonger dans sa mélancolie, ses faux airs de Haïku, et de partager, malgré les obstacles, son avancée résolue dans une inspiration qui tient chaud contre vent, pluies et froidures. Il faut lire la poésie de Michel Diaz !
Fêlure de Michel Diaz aux éditions Musimot

Bernard Henninger

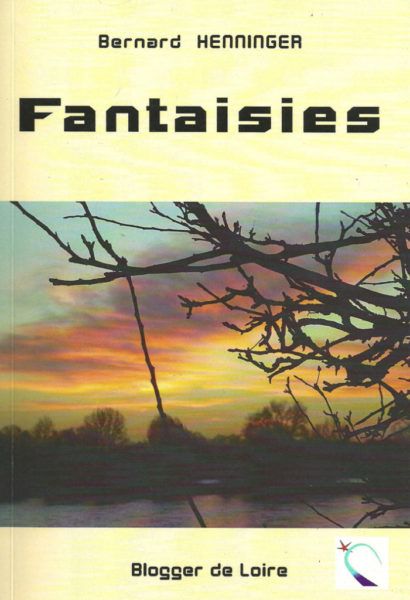 FANTAISIES
FANTAISIES