
Mes anticorps
Jean-Pierre Otte
Le temps qu’il fait (2023)
Note de lecture à paraître in Diérèse N° 92

Mes anticorps
Jean-Pierre Otte
Le temps qu’il fait (2023)
Note de lecture à paraître in Diérèse N° 92
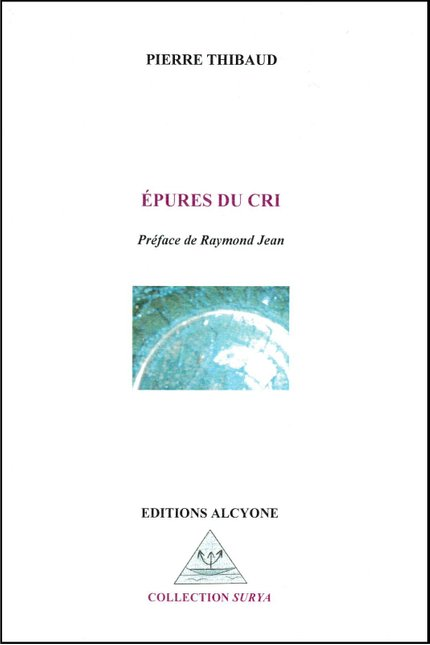
Epures du cri
Pierre Thibaud
Epures du cri
Editions Alcyone (2024)
Note de lecture publiée in Diérèse N° 91 (automne 2024)
Il y a un instant où le monde te creuse / un instant entre la vague et l’écume / entre voix et écho. Ce sont les premiers vers de la première section de ce recueil, intitulée Imminence. Cet instant est celui d’un suspens où Parfois le monde s’ouvre comme une mélodie / d’églantines, où Tout est déjà là / et pourtant à l’écart, instant où quelque chose veille qui ne s’est pas encore révélé, mais est sur le point de s’offrir, frémissement de l’aube, bond de l’insecte, course du vent. C’est ce que les mots du poète tentent de capturer, ce qui se tient aux limites du visible et de l’invisible pour devenir soudain / présence. Imminence contenue de la présence de « quelque chose qui veille », pour reprendre les termes de la préface de Raymond Jean que rappelle Pierre Thibaud
sur la quatrième de couverture, et qui réclame affût des sens, animalité et humanité au diapason de la précarité, le monde sensible étant alors perçu et restitué par petites touches, à petites gorgées, à l’entaille du poème, au contact de la terre, de l’air et de l’eau. Etat de fusion de vif à vif, non de confusion, où se fait chair le bruissement de la lumière / comme un long baiser / des lèvres du couchant. L’écriture se veut, sous la plume de Pierre Thibaud, à la fois quête et révélateur de l’être et du monde, cérémonial intime des sens en éveil. Mais l’accueil des sens n’est là ni béat ni passif. A la réalité furtive et insaisissable du monde font écho ce désir d’entrer dans le plain-pied des choses, ce sentiment de vivre dans les mots, au bout desquels le monde n’est pas en attente mais en suspens, comme feu en extase, feu qui, dans le poème, m’appelle / m’épelle, où le poète devient braise / projetant mille étoiles / à la face du temps. Elan de corps et d’être qui peut faire mal au dehors, brûler au-dedans, le poème est encore, par le corps du poète, lieu de passage / battu de vents contraires / cherchant chaleur et lumière, et réceptacle d’émotions, en éclats d’encre, égrenant le sens, exacerbant la sensibilité, entre onirisme et introspection, et jouant d’analogies insolites : tu voulais toucher / la grappe des sons sentir / le grain lissé par l’air. Les images se font, sous sa plume, découpage à vif et écheveau de sensations, ambivalence et ricochets de signes dans le blanc sans fond de la page : Toute une vie à questionner / la même terre / dans le silence qui brûle / le cœur // dans le fol espoir de retenir / la dernière aube / auprès / du lit.
Tu te succèdes / un et multiple / comme sur une note étale / la mer aux voix innombrables. Ce sont là les premiers vers de la seconde section du recueil, intitulée Nœuds. Et le poète ajoute un peu plus loin, dans le même poème : le monde s’écrit aux nœuds / où tu commences. Si nous sommes cet « un multiple » qui vibre de toutes les rumeurs du monde, mais où l’être parfois risque de perdre pied, il est possible cependant d’opérer une réconciliation de nous-mêmes aux nœuds de cette chair des choses, quand l’œil commence à regarder. Car regarder, ce n’est pas chercher à saisir, par tous ceux qu’à la fois nous sommes, la complexité de ce qui nous cerne, encore moins à posséder. Regarder, c’est plutôt consentir à être surpris, saisi en son être profond par cela même qui est insaisissable et celé dans les « nœuds » du réel, par ce qui apparaît, quand on laisse venir une de ces images qui nous touche et nous ramène à l’essentiel de ce que nous cherchons à être, à l’intime unité de notre regard, à cette note étale, comme ce soir d’été / (où) la peau nue de la lumière / se teinte d’ombre / et se vêt de silence, ou cet instant où l’on perçoit le tressaillement de la sève / et de l’écorce / sous la caresse du sang. Alors le regard s’ouvre jusqu’à accueillir l’intimité des êtres, et ce sera par exemple avec la fraîcheur qu’on sent exister au plus profond du ciel, pour un contact aussi fort qu’avec toute chose au monde que l’on touche, dont on sort éblouis / cœur en fête / corps apaisé. Comme il suffirait, écrit encore Pierre Thibaud, pour la mer / d’une goutte d’eau / pour la prairie / d’un brin d’herbe / pour que le ciel s’éclate à nouveau / et que l’éternité / s’ajuste à nos corps / comme un sourire à nos lèvres. Il nous faut alors obéir à l’extrême lenteur des choses / qui nous use jusqu’à la transparence / limant le chemin de nos veines / différant l’horizon / nous dispensant de mourir.
Vois ce sont là traces de guetteur / entre instant et mémoire // faille fil fragile / où l’immobile est frontière. Ce sont là, enfin, les premiers vers la troisième partie du recueil, Traces. Et Pierre Thibaud d’ajouter, quelques pages plus loin : Tout est écriture / et face à la fenêtre / tu lis à ciel ouvert / dans l’alphabet bleu / ponctué d’oiseaux. Approche-t-on là l’essence de l’émotion poétique ? Oui et non. Non, si nous pensons à la poésie comme à cette lutte amoureuse au sein de la langue contre ses propres pesanteurs, travail où la fraîcheur de l’émotion, liée au surgissement des premiers mots, risque toujours de se perdre, mais dont le poète sait pourtant mystérieusement raviver l’ardente lumière. Tu y apprends / la langue des oiseaux / pour mieux parler à toi-même, écrit le poète, qui nuance pourtant en écrivant, quelques pages plus loin : Natures à vif / qui me malmènent / faisant sans cesse échec / à mes mots, ou encore, je cherche un mot / qui devienne un poème / qui ne pourra s’éteindre. Oui, pourtant, si nous pensons à la poésie comme à ce qui vibre dans le monde, « autre monde » qui ne renvoie à aucun arrière-monde métaphysique mais qui est bien dans le monde, en-deçà tonal où l’on ne pénètre que par rencontre fortuite, sortilège du hasard. Est poète celui qui, selon les mots de René Char, « prend contact avec cette poésie dans un instant inévitable, au seuil d’une rencontre nécessaire, et si peu recherchée qu’il peut ne pas en ressentir sur le champ l’emprise ». Et c’est en terre d’oubli – notre mémoire – que se porte et se dépose l’appel, le ton des choses, comme ces graines que le vent emporte et oublie enfin quelque part, cet appel qui jette le poète dans « l’état d’émotion poétique » comme le disait Pierre Reverdy. Ainsi, Pierre Thibaud peut-il écrire : Il donne à la terre / la lumière de ses yeux // elle lui offre en retour / les mots enfouis / aux veines secrètes. Ou encore : Je naîtrai / de mes mots de sang // ferai crépiter ce qui ne parle plus / dans l’image plus forte que le feu, et dans les dernières pages du recueil, Des voix multiples / chantent en moi / parsemant la basse continue / d’étranges notes de passage.
D’étranges notes déposées sur la page dont le lecteur-passant s’étonnera peut-être, reconnaîtra et fera siennes, contrariant de la sorte la réflexion quelque peu résignée du poète, à la fin de l’ouvrage, à mettre sur le compte de l’humilité nécessaire à tout acte de création : Ephémère l’empreinte / laissée de mon passage // mes mots s’effacent / sous les coups de gomme / de mes rêves. Réflexion complétée par les derniers mots du recueil : En ce temps-là tu vivais / de métaphores comme miroirs / où le monde engrangeait ses reflets. Mais, ajoute le poète, la dernière métaphore s’ouvrira / dans une terre craquelée / fouaillée / par les gestes lents du vent. Et cela justifie ce qu’écrit Raymond Jean dans sa préface au recueil : « Quelque chose tremble ici sans cesse entre la peinture et l’écriture. Une voix particulièrement discrète et juste ». Une voix que les gestes du vent ne devraient pas se hâter d’effacer, n’en laissant que la trace.
Michel Diaz, 06/06/2024

Mont Ventoux, vues et variations
Angèle Paoli, Caroline François-Rubino
Editions Voix d’encre (2024)
Note de lecture publiée in Poésibao (12 juin 2024)
Nous connaissons Les Trente-six Vues du Mont Fuji deHokusai, une des premières séries, dans l’histoire de l’estampe japonaise, entièrement consacrée au paysage, série dans laquelle l’artiste a révolutionné l’art pictural de son époque. Et voici, comme en complice écho, ces trente-six vues et variations sur le mont Ventoux que nous propose ce très beau livre, illustré par les saisissantes peintures de Caroline François-Rubino qui accompagnent les poèmes d’Angèle Paoli. Le Ventoux, dont le nom siffle / à son étrave dure / et fend sans coup férir.
Point culminant des sommets du Vaucluse, surnommé le Géant de Provence ou le mont Chauve, le Ventoux, qui se hisse à presque 2000 mètres, est le seul de ces monts que son isolement géographique rend visible sur de grandes distances (et cela a son importance). C’est en raison de ces particularités qu’il fut et reste une figure symbolique de la Provence, qu’il a alimenté nombre de récits littéraires, et maintes représentations artistiques. Angèle Paoli nous rappelle d’ailleurs, dès les premières pages du livre, que la première ascension documentée du mont jusqu’à son sommet serait l’œuvre, le 26 avril 1336, du poète Pétrarque depuis Malaucène sur le versant nord : Ton plus ancien randonneur / et peut-être le plus célèbre // Pétrarque le toscan / amant de Laure de Noves. Francesco le toscan, dit Pétrarque, qui se lança / un clair matin dès l’aube / sur tes pentes ardues // […] n’emportant dans sa besace / qu’un peu d’eau fraîche / et de quoi subsister / sur la sente.
C’est dans cette lignée de témoignages et de documents que s’inscrit cet ouvrage qui rend hommage au mont en en faisant le seul et unique motif, représenté par la peintre toujours du (presque) même point de vue, les multiples variations étant essentiellement celles de la distance, d’un changement discret de l’angle du regard, ou l’emploi des couleurs et leur application sur le papier, sur lequel elles se diluent ou émergent en signes plus vifs, hachures, glyphes, traces de gestes, buissonnements de formes plus ou moins indéterminées (arbres, forêts, roches, replis de terrain, combes, ravines…). Mont Ventoux, vu toujours de loin, comme le mont Fuji sur les estampes. De fait, les Japonais disent souvent que c’est de loin que l’on peut comprendre au mieux sa splendeur. Et, en effet, dans cet ouvrage aussi, la beauté majestueuse du Ventoux apparaît dans toute sa force lorsqu’on la contemple, comme le fait Caroline François-Rubino, à partir des paysages environnants ou de certains promontoires. Images que l’on ne dira pas vraiment « figuratives » ou « représentatives » dans les procédés et les intentions de l’artiste, mais plutôt « figurales », donnant à voir des formes primordiales, des courbes initiales, des lignes de tension entre regard et traduction de sa vision, réel et interprétation de celui-ci, perceptible et imperceptible, coups de crayon ou de pinceaux réduits souvent à l’essentiel et amples plages de couleurs, fluides et détrempées, ou à la pigmentation saturée. Images lumineuses et solaires pour quelques-unes, rougies au feu du crépuscule ou se bornant à peu de chose comme le sont esquisses et épures, offrant l’espace d’une perspective ouverte sur les pentes et le lointain du mont. Dans les autres de ces images, l’essentiel du corpus, s’invite une palette de couleurs, relativement réduite, déclinaison de bleus, de gris, de bistres, de blancs et de noirs qui confèrent à ces images du Ventoux, brouillé de brumes ou noyé de nuages, au sommet caressé quelquefois par un léger ciel bleu ou rose, ou plongé dans les ombres de l’avant-nuit, peut-être celles d’un prochain orage, quelque chose d’un peu fantomatique et d’un peu inquiétant, voire de fantastique. Comme en ces moments où la brume surprend l’imprudent / pris par surprise / dans la nappe ouateuse, écrit Angèle Paoli, qui ajoute, plus loin, Il faut alors prendre patience / s’arrêter s’enrouler / dans ses laines / attendre qu’un rai de lumière / filtre et que soudain dans la lenteur / se dissipe la ouate dense. Car il arrive, lit-on dans l’un de ses poèmes, qu’un brouillard // – aussi dense que par nuit d’hiver – // enveloppe le Ventoux / le camoufle absorbe / sa lourde carrure / le fasse disparaître. Et la poète de nous dire encore : on en est quitte pour la peur / peur de l’avalement / peur de l’errance / peur de la chute peur / de disparaître. Car même si le mont Ventoux domine un paysage de vastes vignes / gorgées de soleil / qui s’étirent à ses pieds, paysage soumis à un régime méditerranéen qui déploie ses ors / ses mauves ses parfums / sa nonchalance / sa douceur de vivre / à l’ombre des platanes, il ne faut cependant pas trop s’y fier. Le Ventoux est un ours qui sommeille nous prévient la poète. Il peut y faire, pendant l’hiver, un froid glacial, pendant l’été, une chaleur caniculaire, et les pluies y sont particulièrement abondantes au printemps et à l’automne. L’eau de pluie qu’il reçoit s’infiltre alors dans des galeries et rejaillit au niveau des résurgences, parfois sous forme de torrents : Sur le flanc Nord du ventoux / plus secret et plus sombre // le long du torrent / Toulourenc / le château médiéval d’Aulan. En outre, son altitude induit aussi une grande variété de climats, de sommet au climat de type montagnard (végétation rampante / que l’on croirait imaginer / venue de l’Arctique) où s’invitent neige et brouillard, en passant par un climat tempéré à mi-pente. Le vent peut y être très violent (le mistral le balaie une bonne moitié de l’année) et les orages qui l’assaillent y sont terribles : Tu es là, nous le confirme Angèle Paoli, / fidèle au poste / blanc de neige et sapé / par le froid / sur blanc de rocaille // secoué par gros temps / caniculaire l’été.
Mais si le Ventoux est l’élément principal de cet ouvrage, il ne constitue pas pourtant, nous semble-t-il, son but essentiel. Le thème principal qui en ressort est davantage l’illustration du rapport entre l’homme et la nature. Et l’invitation à approfondir ce rapport se trouve là, justement, où l’homme n’est pas picturalement représenté (ce qui ne l’empêche pas d’être présent – à travers l’œil du spectateur, en même temps que dans celui du lecteur) : Au lendemain de la Libération / présence en ces lieux / de René Char // « Sur les hauteurs 1947 ».
Et cela nous conduit à évoquer le rapport entre la nature, l’homme et son besoin intime de spirituel puisque, revenant un instant à Pétrarque, nous savons que pour ce dernier le Ventoux, au-delà de sa réalité, devint le support symbolique de sa quête spirituelle, le théâtre propice à sa méditation, le chemin de sa conversion. Et qu’il l’invita à marcher / marcher où s’échancre la lumière, comme l’écrit Angèle Paoli citant Pierre-Albert Jourdan. Et le spirituel est la voie offerte au sacré. Ô divin Ventoux, écrit encore la poète, qui nous rappelle aussi le premier de ses noms, gravé dans la pierre // Vintur // à l’étymologie foisonnante / dieu du Mont vénéré / par les celtes. Car nous savons depuis toujours que tous les lieux où il y a quelque chose de sacré sont comme cela : isolés, entourés de solitude et de vent, très hauts, près du ciel. Comme nous savons aussi que dans toutes les croyances, la montagne apparaît comme un symbole de la transcendance spirituelle. Chaque religion possède une montagne, demeure des dieux, ou d’un dieu, lieu de pèlerinage souvent, marqué par le séjour de personnages historiques, lieux auxquels sont liés nombre de légendes, comme le mont Fuji que nous évoquions plus haut. Certes, à côté des 3776 mètres de ce dernier, le Ventoux n’est qu’un modeste sommet traversé de ces drailles (qui) ont ouvert / des sentes nouvelles / passages tout en sonnailles / et laines blanches / des troupeaux. Mais il n’empêche que, quand la masse nébuleuse des nuages recouvre le sommet du mont, seule émerge du dos à dos / une pointe effilée / qui perce de son aiguillon / le chapeau neigeux / du roi des nuages, lui accordant ainsi ses lettres de noblesse. Mont admirable nous dit Angèle Paoli, carène blanche, navire qui navigue ouvert à tous les vents / drossé par leur souffle. Et les mots de l’auteure en font ce vaisseau de pierre qui file droit devant / dans les nuits étoilées / mobile immobile / géant confiant / en sa puissance millénaire. Et l’on sent passer dans ces mots le souffle du sacré, que les mots du poème se retiennent de prononcer : ne demeure de son essence / que l’idée de son être / rivé en majesté / depuis des ères / posé là sur son socle / qui domine // la Provence. Sentiment du sacré qui pourtant se fait jour encore dans ces vers, Au-dessus de la Sainte-Baume / comme au-dessus du Ventoux / plane […] // le circaète Jean-le-Blanc, cet oiseau reconnu pour son admirable vol stationnaire et dont le surnom est « vol en saint esprit ». Comme dans ces autres vers, plus explicites encore : le Ventoux lisse / son visage tutélaire / de divinité. Ou ceux-là, qui évoquent les profondeurs mystérieuses de l’être, touché par la révélation de ce qui le dépasse : Les voix du dehors / s’assoupissent s’apaisent / qui laissent filtrer diffuses // […] les voix du dedans.
Si nous ne sommes pas ici (et pourtant pas si loin…), dans la conception shintoïste du monde, cette religion japonaise basée sur la vénération des dieux et des esprits, en syncrétisme avec la nature et qui met l’accent sur la signification spirituelle de phénomènes naturels tels que les montagnes, les rivières, les arbres et les pierres, nous sommes malgré tout, dans la contemplation du mont Ventoux telle que cet ouvrage nous la propose, invités à marcher sur la « voie des dieux ».
Mais nous nous contenterons, inspiré par le beau travail d’Angèle Paoli et de Caroline François-Rubino, d’évoquer ces deux autres chemins. Le premier, celui de René Char dans sa Lettera amorosa : « Je vais souvent à la montagne dormir. C’est alors, en vérité, qu’avec l’aide d’une nature à présent favorable, je m’évade des échardes enfoncées dans ma chair, vieux accidents, âpres tournois ». Le second de Jacques Dupin dans son poème Sang, in Dehors : « alors il va aux montagnes / de préférence – grises / et rauques, s’aguerrir / et sa vieille torpeur mettre en pièces ». Deux chemins de la paix de l’âme, que ces mots d’Angèle Paoli ne peuvent qu’approuver : Le Ventoux / dans son silence habité / par les grands souffles // libère l’espace intérieur.
Michel Diaz, 31/05/2024

Eveil trois fois
Pierre Dhainaut
Les Carnets du Douayeuf (2024)
Note de lecture publiée in Poésie sur Seine N° 113 (sept. 2024)
Ce court recueil, solidement construit, est divisé en trois sections de 6 huitains en vers libres, chacune d’elles commençant par les mêmes mots, qui pourraient leur servir de titre : I. A l’écart, à l’étroit ; II. Eveil, le juste éveil ; III. Ouvrir les yeux, ouvrir.
Nous pourrions mettre ces 18 poèmes en regard de ces mots de Montaigne à propos de la poésie : « Quiconque en discerne la beauté, d’une vue ferme et rassise, il ne la voit pas, non plus que la splendeur de l’éclair, elle ne pratique point notre jugement, elle le ravit et le ravage ». Et en effet, dans ce recueil, qu’est-ce que la beauté qui nous ravit et nous ravage, dans l’éveil du regard et des sens, et dans celui de la conscience, sinon un nouveau souffle qui permet au poète de dédier le nom de « neige » à la nuit inconnue, un murmure, tumulte, ruissellement, lumière, / sur les galets, ou encore un rayon / qui semble émaner d’une déchirure / des rideaux rouges ? Ou bien encore, ouvrant les yeux, sans souci des questions ni d’aucune réponse, le pouvoir de capturer, plus lent, plus / vif, ce vacillement d’astres / et pour chacun imaginer un nom ?
Ces pages, où le poète semble tout d’abord déplorer que (son) regard ait perdu le pouvoir d’élargir la perspective, où il lui faut ouvrir en ces couloirs / l’opaque dans lequel nous allons tâtonnant, s’éclairent cependant, de texte en texte, de cette tenace volonté d’aller, par-delà le poème, air libre, grand arbre, / en plein poème. Il s’agit, dans ces pages, de s’inscrire dans les pages ferventes de l’adhésion au monde, d’être tout entier en contact avec un pur Dehors que traversent courants d’énergie, fluxions et fluctuations. On y entend, basse obstinée, comme un balbutiement têtu où s’esquisse une phrase que pousse la suivante, celui d’un cœur battant qui appelle à l’aide, mais travaille pourtant à abattre un à un les murs pour rejoindre / le chœur des souffles. Balbutiement d’une parole qui se cherche, émerge du silence et s’affermit, conduite par le souffle que prolonge la main qui se dévoue et bientôt ne contient plus traces de ténèbres. Parole informulée d’abord, remerciant / ce que l’horizon lui réserve, bousculant en nous, comme instinctivement, de la pensée enfouie, et perçant lentement à travers les stratifications d’un autre règne. Quelque chose qui ne cesse pas de murmurer, dans les basses, au plus près de soi quand soi n’est plus que vide, n’est plus dedans. Ou plutôt que le dedans est dehors, eaux secrètes qui vont s’ajustant aux pierres d’un torrent souterrain, frêles eaux qui, obstinées, poursuivent leur cours. C’est cela que l’on entend, tout au long de ces pages, cela qui fait signe, sous l’immaculé de la neige, ce mot si cher à Pierre Dhainaut, vers d’autres flocons, d’autres splendeurs, / qui nous échappent, qui se confient au temps/ pour ne pas fondre.
On trouvera, dans ces poèmes de Pierre Dhainaut, la résonance de sa voix si particulière dans ce que l’on peut lire par ailleurs. Peu de mots dans ces textes, mais la frappe rythmique d’une parole qui se refuse à désarmer, effet d’une sourde énergie, comme toujours réanimée à la flamme d’un sentiment (qui) se change en certitude, d’une syllabe (qui) existe, ou seulement d’une lettre inlassable / par quoi tout va reprendre essor. C’est ici une poésie presque « dégraissée » à l’extrême, qui sait se dispenser de tout « effet » et d’inutiles métaphores, comme aiguisée au feu d’une persévérance qui entend continuer à refuser d’être vaincue. Qui parie sur une requalification du langage et du monde. Qui opère presque en sourdine, mais dont la lumière tremblée, que le poète sait jamais définitivement acquise, parfois intermittente, lutte toujours avec la porte fermée des jours. Mais chaque année la bonne au jardin d’Eden, / il n’y a jamais eu de chute. Alors exempt de toute faute, et riche des trésors d’enfance, de l’innocence de la neige d’avant notre naissance, tenir encore, debout, nous disent les mots du poète qui nous invitent à rêver d’éveils et à nous réveiller aux rêves, et à penser demain comme un sourire ou bien demain encore.
Tel est le rôle du poète Pierre Dhainaut qui, comme dans l’un de ses précédents ouvrages, Retour sur écoute :, écrit encore ici : deux points / plutôt que points de suspension / sous la pluie fine. Deux points, malgré tout ce qui poisse, et colle. Malgré l’âge, le temps, l’hiver et tous ses froids.
Michel Diaz, 20/05/2024
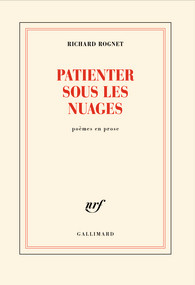
Patienter sous les nuages
Poèmes en prose
Richard Rognet
Editions Gallimard (2024)
Note de lecture publiée in Poésie sur Seine N° 113 (sept. 2024)
Ces poèmes en prose, écrits entre 2016 et 2019, sont composés, pour beaucoup d’entre eux, de longues phrases, voire d’une seule qui occupe tout l’espace du texte, semées d’anaphores et de formules qui donnent à ces textes l’allure d’une lente confidence crépusculaire où apparaissent çà et là des éléments autobiographiques, comme se délivre de l’ombre une voix dans laquelle l’auteur, toujours présent sous la forme du « je », nous accompagne, page après page, dans une langue simple, souple, quelquefois familière, si près de nous que nous pourrions sentir sa main posée sur notre épaule. La voix de Richard Rognet, grave et sombre souvent, aux accents volontiers élégiaques, est d’abord cette voix amie qui chuchote et murmure, sans jamais hausser le ton, s’enroule et se déroule comme va un ruisseau sous le couvert des arbres, charriant, blessé de pierres et de branches mais irrésigné, ces éclats de furtives lumières dont nous éblouit la soudaine émergence.
Cheminement paisible mais tenace de ces mots, assombris cependant de questions sans réponse et de sourde inquiétude. Cheminement des mots, comme chemine la vie même et cheminent les souvenirs, les images d’un monde où l’on se demande toujours quelle y est notre exacte place : Les chemins, ô les chemins ! qui conduisent mes pas jusqu’aux murs étouffés sous les ronces brûlantes, jusqu’aux rêves rêvés sous des rêves infinis, jusqu’aux fleurs en allées, jusqu’aux enfants perdus dans les tumultes de la vie.
Ces lignes, qui ouvrent le recueil, donnent déjà le ton de tout ce qui va suivre, laissant à la poésie, le meilleur des guides, le soin de creuser la mémoire et d’orienter le regard à travers la réalité, vers ce qui peut venir la trouer, ces riens – c’est cela le réel – qui se laissent rencontrer et souvent dans l’inattendu. Ces riens qui ouvrent des passages afin d’offrir à la réalité cette chance de vie. Mais encore faut-il, pour que puissent s’ouvrir ces passages, se confronter aussi à la réalité et ce qu’elle contient de moins séduisant : Où donc résident les jardins voués aux fleurs, à leur plénitude, à leur fragilité […]. / Je perçois d’intenses cruautés, je vois de lointaines barrières, les portes de l’ombre s’ouvrent sur des forêts meurtries, des maisons éventrées, des jardins où ne s’ébroue plus la lumière, où ce qui se déclarait humain n’est plus que le mortel frisson d’un temps sacrifié, mutilé, sans oiseaux, sans arbre devant lequel se prosterner, sans rive où la mer s’ouvrirait comme des lèvres d’enfant dont le visage éclairerait tout ce qui vient à nous pour croître dans l’incessante fertilité de l’amour.
Mais Richard Rognet est avant tout un poète de l’inquiétude et du questionnement existentiel. Il est de ces poètes à qui la lumière n’est pas spontanément donnée, mais qui doivent se battre pour la trouver, en jouir un fugace instant, avant qu’elle leur échappe à nouveau… Vivre est pour lui, ainsi qu’il nous le dit, dans la quatrième de couverture, « Toujours ce même combat au cœur des ténèbres. Pas de pitié, pas de gratitude, pas de consolation ». Toujours sur la crête de ces instants qui volent en éclats, l’aventure de vivre nous serait cette épreuve « où aucun de nos gestes n’a su prendre le temps de s’allier aux mouvements si purs des plantes, des herbes, des fleurs ». Fluide, feutrée, exempte de trop vives aspérités, sa poésie, creusant son lit entre abandon et veille, nourrie de réflexions sur nos précaires existences, le temps qui passe, la douleur, la mort, est celle d’un rêveur solitaire aux yeux écarquillés sur le temps qu’il traverse, d’un promeneur qui s’achemine, dans l’espace du monde et celui, intérieur, de lui-même, à travers les méandres insoucieux des saisons et des jours automnaux qui descendent vers les ténèbres, affrontant patiemment sous de sombres nuages cette énigme insoluble qu’est l’existence, mais portant à dos d’homme, sans désespoir pourtant, cette « obscurité maladive » dont souffrent nos paroles. Ainsi, peut-il écrire, je suis l’homme de passage, le fragile chemineau qui ne sut jamais où ses pas le menaient, le visiteur consterné devant des portes muettes qu’il n’osa pas ouvrir. Ou encore, plus loin : Je ne suis qu’une rencontre confuse, un sang desséché sur des pentes invisibles, qu’un tremblement sur des mains enfantines, je ne suis qu’une barque égarée sur des eaux lointaines, une espèce de forme qui n’est rien d’autre que ce qu’elle aurait voulu partager avec une autre force qui s’est dérobée ou éteinte.
Si le récit est le lieu par excellence de la mémoire, si raconter c’est toujours vouloir d’une certaine manière conserver, maintenir intact, si on y bâtit des palais chimériques, en revanche les poèmes de Richard Rognet, où l’on décèle quelquefois une tentation narrative, s’avancent sur les ruines d’un impossible récit. Ruines d’une existence questionneuse dont il ne reste que des bribes, des braises sous la cendre. Et qui perdurent. Car les poèmes sont les fictions de l’oubli. Ils se déploient autour d’un trou, d’un centre qui manque. Ou n’apparaît que pour se dérober, ou pour nous y faire tomber en partie. Un oubli. C’est dans les creux de cet oubli, d’où fusent les réminiscences, que Richard Rognet s’efforce de « dire », en ces blocs rythmiques de phrases (semées d’alexandrins), dont il n’importe plus de savoir si ce sont là des vers, des versets ou des proses. Mais qui sont le théâtre de ces présences (comme celles des disparus) que la nuit lui révèle et fait rougeoyer, et c’est alors l’absence de ce qui est absent qui se lève et se montre : J’entends la nuit passer sur le chemin du vent. Qui suis-je pour saisir un semblable secret ? qui suis-je pour ainsi interroger ma mémoire et mes songes où s’empilent les vies de ceux qui m’ont quitté ? […] qui suis-je pour ainsi me confondre avec ce qui remonte des creux de mon passé, et qui ne saura point délivrer le présent où je piétine, comme une sève malheureuse qui ne parviendrait plus à grimper dans les arbres ? Cette clarté sans repos est celle qui préside aux errances dans le labyrinthe, aux longs des lignes brisées de son tracé, de ses pièces et galeries. Là, dérive la mémoire, détachée de tout ancrage, de toute mémoire ordonnée, là où brûlent les pertes. Là où le sujet qui s’y aventure se perd dans les fils de la mémoire devenue épervier d’oubli. Non d’un oubli pur et simple, mais d’un oubli en acte, pensée qui se sait désarticulée, qui comprend qu’elle erre dans un labyrinthe, impuissante à rétablir les liens entre les pièces qui s’ouvrent, à raccorder les corridors entre eux. Dans les pages de cette clarté sans repos, Richard Rognet sait faire parler l’oubli sans avoir pourtant prise sur le secret. Perdu désormais : A force d’hésiter devant mon propre seuil, de vibrer contre les murs avec les ombres échappées de mon corps, à force d’être en même temps le dedans et le dehors, la plainte et le silence, et le silence sous une autre plainte, sous le silence un autre silence, sans que je puisse trouver le fil qui déroulerait la pelote embrouillée de mes traces, sans que, de la lucarne qui limite ma vue sur le monde, je puisse retenir, au plus profond de mon désir d’être moi sans moi, l’espoir d’un calme parfait…
Mais dans ces poèmes, troués d’éclats de lumière, comme cette lumière infinie qui repose sur tout et sur rien, la lumière engagée dans l’épaisseur des mondes qui jaillissent en nous, se pose malgré tout quelque chose qui nous console, qui tient à la beauté du chant, à ce qu’il parvient à reconquérir de couleur de la vie et du temps, et de ces lointains sans arrêt espérés qui ne renient jamais la joie de patienter sous les nuages.
Michel Diaz, 26/04/2024