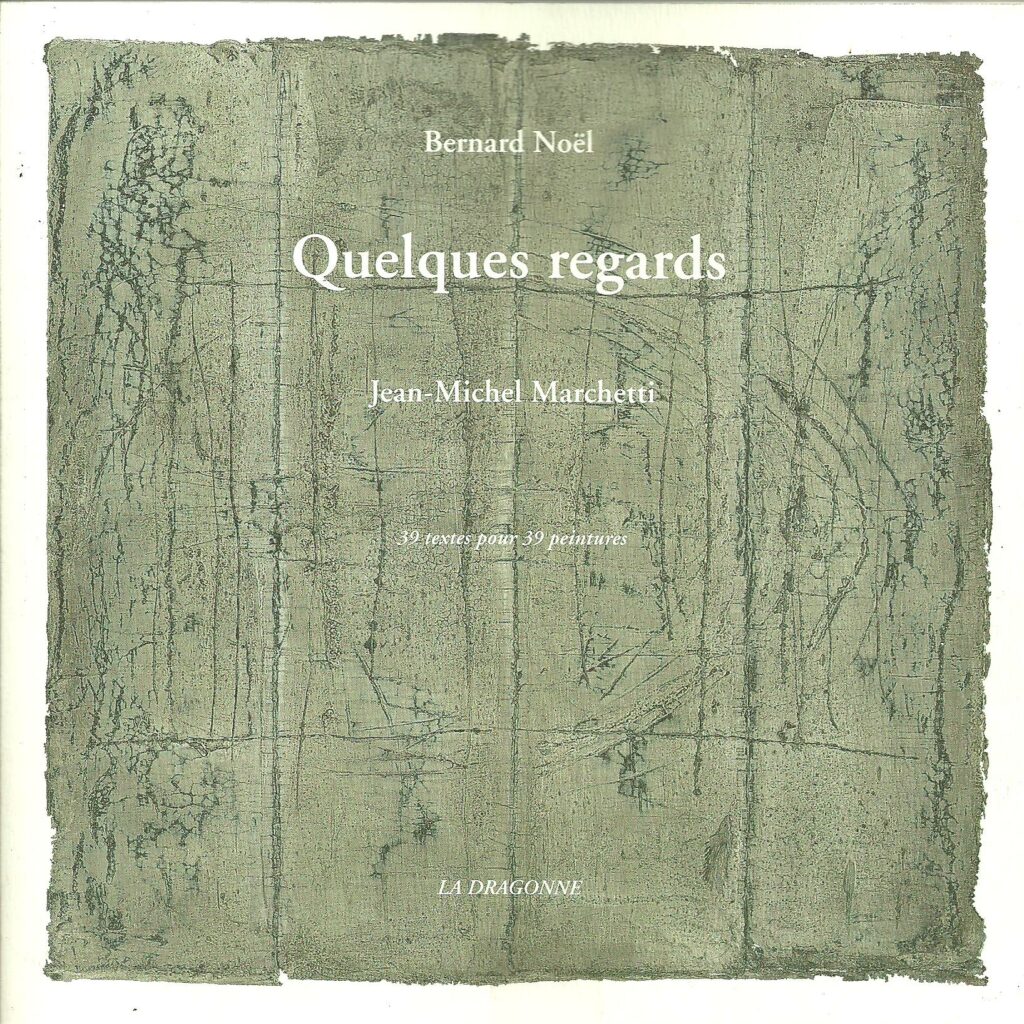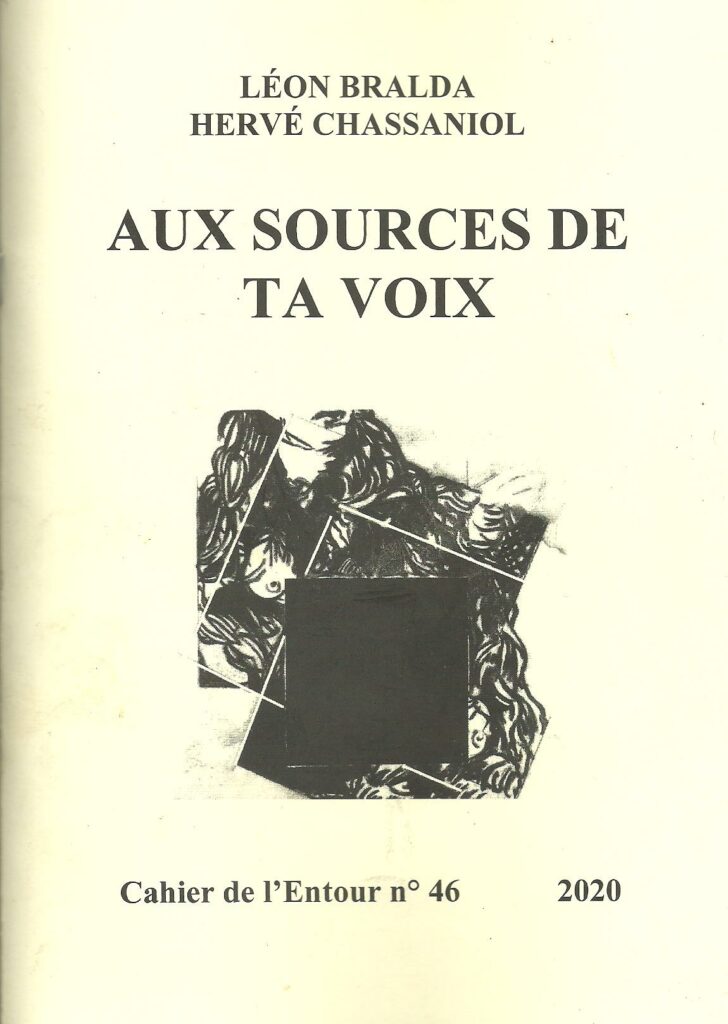« A L’AUBE DE LA VOIX », poèmes de Léon Bralda, gravures de Lionel Balard, éditions Donner à voir, Collection / Séries Petits Carrés (2020)
Chronique publiée in Terres de femmes, juin 2020
Lecture de Michel Diaz
« A l’aube de la voix », nous dit la quatrième de couverture, est un texte
qui répond à « l’impérieuse nécessité pour ce poète (que) de toujours revenir par
le travail d’écriture à la maison natale, en ces abords de la jeunesse qui ont
irrémédiablement façonné sa perception du monde ».
Ce livre, dédié à un vieil ami de l’auteur, aux parents du premier,
évocation de leur maison et de jours d’insouciance, est bien une tentative de
retour amont sur les terres d’enfance, ainsi que son annonce le souligne aussi :
« Au plus loin de ma vie, dans le vacarme incessant où se déchirent les matins
jeunes, il fut un lieu clos, un jardin où le ciel reposait dans la douceur de vivre et
le bonheur d’une famille ».
La présentation de l’auteur, à la fin de cet ouvrage accompagné de neuf
gravures, nous rappelle que le poète Léon Bralda et le plasticien Lionel Balard
ne sont qu’une seule et même personne.
Si le plasticien illustre les textes du poète et s’en fait l’écho dans de sobres
et belles images que le seul recours au noir et blanc contribue efficacement à
« dramatiser », le poète laisse deviner le plasticien qu’il est en même temps. En
ce sens, la publication de ce livre par les éditions Donner à voir nous semble on
ne peut plus pertinente ! En effet, et davantage, nous semble-t-il, que dans ses
autres textes, le côté « visuel » de cette écriture semble s’y inviter avec plus de
prégnance encore. C’est aussi bien, en éclairs de réminiscence, la silhouette de
« la mère aimante et sombre derrière les volets », que « le long trottoir
d’asphalte et de poussière », « le chat maigre endeuillé par la nuit pourpre »,
« l’éclat fulgurant du jour sur le corps des fenêtres », ou encore « la porte
endeuillée où rouillent quelques clous ». Mais c’est aussi le ciel « lourd d’un
orage grêleux », « un jour de pluie posé sur les carreaux de la fenêtre », « ces
fronts de vigne dans leur parfaite géométrie »… Images de la langue poétique
dont la référence explicite à l’environnement ou à ce qu’en fait la mémoire,
suscitent aussitôt les images d’un monde dont s’empare l’esprit du lecteur et qui
parlent à l’œil de son imaginaire, lui laissant tout loisir de les faire siennes.
Cette « perception du monde » évoquée plus haut est ici d’ordre
« expérimental », celle que façonnent les sens d’un enfant qui découvre et
s’imprègne du monde, s’y avance pour s’y inscrire ou, plus exactement, s’y
aventure, déjà lourd des questions qu’il ne cessera plus de se poser face à cette
ouverture d’inconnu qu’est l’énigme de l’existence.
L’expérience sensorielle du monde, c’est ce qui emplit le champ du
vacant, y plante ses repères, y sème ses possibles, en nourrira sa nostalgie. C’est,
en premier lieu, bien sûr, le regard et ce qui s’y est déposé, « la déraison d’un
ciel de mai, quand saignent les lilas », « le blé révélé par un soleil latent » et
« court au terme des moissons », « l’herbe qui jaillit comme le sein de lait offert
à la terre natale », « les thuyas de l’allée, au pied d’un mur d’enceinte », la pluie
« sur les rosiers, les iris et les statues de ciment qui peuplaient le jardin », c’est
« la beauté d’une lueur pendue loin derrière les bâtisses ». Ce qui s’invité à cette
faim de monde, ce sont aussi les bruits, partition en fond de mémoire, le
murmure des fontaines qui « prendront dans l’herbe et jusque sur les vitres », les
mêmes thuyas qui « se font encore entendre », qui « chuchotent parfois sous le
débord du vent », les volets et les portes qu’on ouvre, le ciel « avec ses
grondements et ses râles de bête ». Partition où s’accrochent encore des éclats de
voix humaines, ce si lointain « à tout à l’heure, mon garçon », « ces mots, depuis
toujours, pour prendre l’heure dans le matin, sur le chemin des écoliers », ceux
des leçons jadis apprises et qui ânonnent, dans le souvenir, « les siècles de
l’Histoire que gouvernent les cartes, les lois aux temps écrits qui accordaient le
verbe », ces voix qui, plus tard, « viendront broder aux pas de la marmaille le
moindre souffle d’air », les cris accompagnant « les jeux qui auront germé dans
l’heure vagabonde de la récréation », le cri d’appel au « chien échappé de
l’enclos depuis la veille ». Images visuelles et sonores, olfactives encore,
puisque ces « terres avaient l’odeur des romarins, des menthes et des tilleuls »,
qu’au creux de la cave régnait « l’odeur du jour mourant de trop de solitude »,
que flottait parfois cette odeur sur les « terrains vagues dans lesquels ont brûlé, à
chaque canicule, les ronces et les chardons ». Mais aussi odeurs de la mort dont
on fait, à cet âge, la première expérience, celle de la bête « crevée depuis
longtemps déjà », des eaux qu’elle a souillées, qu’on enfouit au fond d’une fosse
tandis que « des enfants s’étaient assis sur le bord du talus et jetaient leur visage
dans l’ordinaire des immeubles ». Expérience parmi les plus décisives puisque
« le jardinier venait de retourner un peu de terre et nous savions quelle énigme
se formait à l’endroit du labeur ».
Expérience que forgent les jeux l’enfance : jeux de l’apprentissage de la
vie, en même temps que jeux de guerres et de mort, les uns étroitement mêlés
aux autres puisque, comme l’écrit l’auteur, « Nous mimions l’agonie et l’horreur
des batailles, et nos mots étaient ceux des gorges incendiées ». Puisque, ajoute-til, « Nous mourions aux confins de nos joies (…) Nos guerres avaient le poids
du jour et l’heure de nos cris », et que « dans les jeux de l’enfance, nous jetions
les désastres d’autrefois ».
Mais Léon Bralda est l’un de ces poètes auxquels la lumière n’est pas
spontanément et naturellement accordée. Il serait plutôt de ceux-là qui
travaillent à la gagner, s’efforçant d’habiter poétiquement le monde comme nous
le conseillait Hölderlin, et qui peuvent revendiquer ce qu’ils en ont conquis sur
le sombre et la terre des jours. Il est de ceux sur qui le ciel de l’existence fait
peser son poids de pénombre, ceux pour qui leur ciel de poète est quelquefois
lourd à porter (je cite inexactement de mémoire ces mots de lui écrits ailleurs).
Parce que « le ciel est lourd de n’être au fond qu’un jeu pour l’enfance
profonde ».
Pour Léon Bralda, les territoires de l’enfance ne sont pas exclusivement
ceux des « verts paradis » baudelairiens. Pour ce qui le concerne et qui remonte
en ses écrits, de façon récurrente, « il y avait l’enfant et toutes les ténèbres qui
mordaient l’œil sous le trop-plein de la jeunesse ». Et si, pour cet enfant qui
inventait l’enfance, le monde s’ouvrait sur son secret, il y avait aussi pourtant
« les sauts allant à la lumière et le soleil éteint derrière chaque allée ». Car
lumière et ombre vont de pair dans l’apprentissage du monde, comme elles vont
de pair, et s’épaulant, sur les chemins rugueux des hommes. Parce que, écrit le
poète, « on n’a pas dix ans quand les cris mordent aux portes closes, que
jaillissent les branches hideuses du regard ». Car aussi l’enfance « laisse l’enfant
venir dans le silence pour des rires épars et des bruits sourds de chairs que
mange la colère ». Premiers bonheurs glanés dans l’innocence des rires et des
jeux, alors que déjà la nuit rôde, que se font mordantes les peurs, que s’ouvre au
fond de l’insouciance cette « chambre effrayée par le bruit de la nuit. Une mort
qui tissait du sang au ventre noir, qui se faisait pressante et avide de tout ».
Puisque encore l’enfant a peur, « dans le mystère de l’enfance » et que, du
monde qui le cerne, comme de celui qui l’attend, il observe déjà et pressent ce
qu’il contient de violence irréductible et d’irrémédiable incompréhensible.
Saison d’enfance, « impudique saison soumise à la question, vieille âme
enchevêtrée dans l’hystérie du monde », saison d’une innocence provisoire où
l’on entend déjà « battre le pouls de tous les morts ». Saison où l’être en devenir,
prêtant l’oreille, serait capable d’entendre aussi, et sans chercher à les
comprendre, dans le bruissement du vent dans les arbres et les murmures des
statues, tous les secrets de la terre, sans encore savoir que « c’est de là que les
rêves surviennent… » Et avec eux, une fois pris par les soucis des jours et dans
les tenailles du temps, « des lendemains d’étoiles et des restes d’orties […] De là
qu’advient le doute, ou la parole pour le dire ».
Car à l’enfant succède le poète, qui n’a que sa parole pour tisonner parmi
les mots, en ressusciter quelque braise, essayer de sauver ce qu’ils ont oublié et
ne savent plus dire. Se souvenir, c’est prendre aussi le risque d’écorcher ses pas
sur les pierres vives du temps, de blesser sa mémoire aux ronces de la nostalgie,
en tout cas de se confronter à la perte de tout et de tous, d’endosser la tristesse.
Tourner son regard en arrière, mais avancer pourtant (que faire d’autre ?), ce
poids d’ombre sur les épaules, dans l’ornière des heures. « Mon pas est lent »,
écrit Léon Bralda, au début de son livre, « Et je suis de ceux-là qui passent
comme tant d’autres, par habitude ! Qui sarclent le rêve au fond de la ravine
(…). Ils sont passés comme je passe : le corps lourd et douloureusement fermé
sur ce peu de bonheur qui l’habite ».
Lumière et ombre, avons-nous dit, se partagent ces pages, sans que la
seconde pourtant prenne décisivement le pas sur l’autre. « Je buvais l’instant
doux de la vie douce », lit-on. « J’allais le cœur halant jusqu’à la paix des
âmes. » Mais l’ombre aussi, parfois, est accueillante et douce. Pour preuve, ces
lignes qui évoquent, dans une lumière de clair-obscur qui pourrait nous faire
penser à quelque peinture de Georges de la Tour, un intérieur paisible et amical :
« Il y avait l’enfant et le soir survenu, l’ombre d’un cerisier cassant la nuit
derrière la baie vitrée et le téléviseur qui racontait le monde ». Scène complétée
par cette autre : « Sur le couvre-lit rouge : un chat dormant de son sommeil de
chat et d’autres nuits à faire au-delà de la nuit. Un miroir ciselé d’ombres
imparfaites, quelques éclats chauds des phares de voitures jetés depuis la route à
travers la fenêtre ». Scène qu’évoque ce poète qui est aussi bien plasticien, sans
effets dramatiques ni théâtraux, scène de la vie quotidienne qu’en peinture on
appelle scène de genre. Qui n’est, en l’occurrence, ici, qu’une scène de bonheur
simple, mais de celles dont les racines s’enfoncent au tréfonds de l’âme, de
celles que l’oubli ne saurait prendre à la mémoire et que le corps « tient d’un
amour infaillible, à l’étroit de l’humain ».
Que faire d’autre qu’avancer, espérer qu’une aube se lève à l’horizon du
jour ? Et espérer, comme l’enfant, se rassurant contre la peur du noir, que le jour
revienne. « Et le jour reviendrait. » Parole de poète aussi, qui quête sa lumière :
« Le soir, c’est sûr ! Il se fera d’argile à l’aube de la voix… Et le jour reviendra,
c’est sûr ! Et le jour reviendra ». Comment d’ailleurs ne pas revendiquer cette
espérance dans (et contre) le désespoir du monde ? Que peut promettre d’autre
un homme debout, et en marche, qui n’avance qu’en faisant corps avec la
poésie ? Parole de poète encore : c’est ainsi que Léon Bralda donne à ses mots la
force douce et vigoureuse des images afin qu’ouverts à ce qu’il attend d’eux, ils
libèrent cela qui en eux-mêmes cherchent à aller plus loin que leur toujours trop
étroite détermination, et qu’allégés du poids des vaines nostalgies, ils remontent
vers un de ces clairs-de-terre dont la poésie nous éclaire.
Michel Diaz, pour Terres de femmes, mai 2020