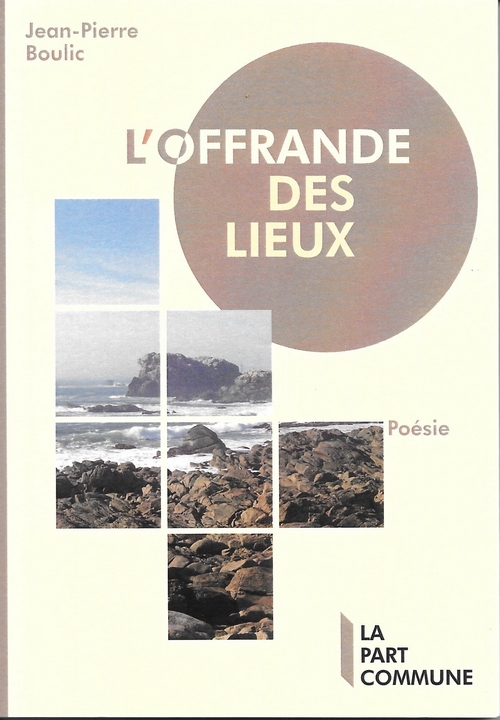Le Bruit des nuits, Léon Bralda
Les éditions du Petit pois, Collection Prime Abord, 2020
Lecture par Michel Diaz, note de lecture à paraître dans le numéro 82 de Diérèse.
« Dans ce nouvel opus, lit-on sur la page de présentation de l’ouvrage, l’auteur nous livre un texte intime, véritable hymne d’amour pour un être cher que la mort avait emporté prématurément… »
Avant même d’aller plus avant dans ce livre, il faut nous attarder sur la belle image de couverture, une peinture de Lionel Balard : une chaise vide sur laquelle ruisselle un jaune lumineux, vers laquelle s’incline une forme humaine, tête noyée dans l’ombre, avant-bras demi replié, main pendante le long de la cuisse, comme hésitant à se risquer vers la caresse ou affronter l’effroi de ne trouver personne. Quelqu’un est là, qui cherche qui n’est plus, présence/absence intimement mêlées pourtant sur la surface de la toile. Et dans cette image qui joue, comme sur une scène de théâtre, de la dramatisation du silence et des objets d’un humble quotidien, se tient déjà, comme en un drame condensé, tout le propos du livre.
Le Bruit des nuits est donc un poème de deuil et d’amour que Léon Bralda dédie à sa mère. Poème que, d’abord, avant d’y découvrir quelles croyances combatives et quelle pulsation de vie le portent au plus profond, on aborde comme chant de deuil et de douleur, un lamento qui s’apparenterait ainsi à ces chants de tristesse et de déploration que l’on rencontre aussi bien dans la poésie que dans la musique. Chants que ceux qui demeurent consacrent à la mémoire de ces disparus à qui l’on rend hommage et que l’on se refuse à laisser sombrer dans l’oubli.
Mais la mémoire des présences disparues, de leurs visages, de leurs voix, est cet espace de l’intime que le temps traverse, bouscule et use dans son flux, aussi injustement qu’inexorablement. Aussi, comme un défi que le poète jette à l’oubli, il formule ainsi, dans un entretien, l’impérieuse nécessité de l’écriture de ce texte : « Porter mémoire… Ne pas laisser le temps qui passe effacer l’image de ceux qu’on a profondément aimés et qui ont à présent disparu. Refuser la part faillible de la mémoire et lutter contre l’oubli qui naturellement s’infuse peu à peu dans nos consciences d’homme, échoppant lentement, inexorablement le visage des êtres chers. » Ecrire alors, car c’est, face à la mort, nous dit Léon Bralda, « Faire acte de résistance en quelque sorte ! Pour ne pas oublier. »
C’est donc en toute cohérence que l’auteur cite, dans son entretien ces mots de Christian Bobin, « Ecrire pour réparer l’irréparable », ou encore ceux d’Alain Borne, « C’est contre la mort que j’écris ».
La poésie alors, et l’écriture, dernier acte de résistance et ultime rempart contre l’effacement de ce que la mémoire cèle de plus précieux (souvenirs du regard, de la voix, des sourires et des odeurs), et dont les mot du poète, mots humains de si peu de poids contre l’arrêt irrévocable de la définitive Absence, ne sont que la seule arme, celle que la peur de l’oubli charge d’invocations, qui sont aussi supplications :
Que tes yeux durent dans l’étroit du matin ! // Que tes nuits échappent / Aux luisances des vitres : / Murmures longs léchant le sable
Mots du poète qu’habite l’éternelle nostalgie des attributs et des pouvoirs d’Orphée, qui se retourne vers la morte pour mieux, la cherchant du regard au creux de la pénombre, la rappeler à lui, ne serait-ce qu’un seul instant, voudrait croire qu’il peut, ne serait-ce qu’un seul instant, la rendre à quelque étincelle de vie ou à quelque éternelle présence dans la si secrète lumière du cœur. Mots grâce auxquels le poète attend que la figure maternelle lui revienne, dans la chambre de sa mémoire, vêtue / d’une clarté soudaine / dans le sourire / d’un enfant / (…) //Source miraculeuse, / chose inexacte qui dure / qui résiste, / qui épuise un chemin.
Alors, ainsi, lit-on plus loin : Vous demeuriez à jamais // Eternelle : // Constellation nouvelle / qui luit au bout / des digues // qui scintille et remue. // Cela même qui reste / Votre voix // Et je l’accueille cette parole / Qu’un souffle / Rend à la lumière. Et ces derniers beaux vers par lesquels se termine l’ouvrage : Que ton sourire soit / inéluctable / au temps.
Pourtant, on lit encore cela, dans une autre page, comme on cède à l’amère résignation : Mais ton sourire, / Ô ton sourire / mère // qu’en est-il advenu ? // Quelle ombre est demeurée / aux lèvres de ton secret ? Alors, s’il faut se résigner devant l’absence, et le vide qu’est cette absence, quand Le vide se vide encore, en dépit de ces éphémères miracles que peuvent susciter les forces de l’amour, comment dire l’absence et son intolérable vide dont les mots mêmes du poète ne peuvent fixer les contours ? La cruauté de cette absence, c’est d’abord cet infranchissable silence qui sépare les rives des mondes, avant que ce même silence se fasse lancinant murmure aux lèvres du jour achevé :
On troqua le silence / contre le bruit des nuits / et dans vos mains inertes // on fit l’heure plus lourde / qu’elle n’y paraissait. // Le jour n’a plus suffit / alors // à votre voix.
Mais même les mots du « plus là, plus personne, plus rien » ne peuvent jamais rendre compte de l’impensable de la mort. Reste la brume du chagrin sur l’impensé de la nuit d’au-delà, le bruit d’encre de ses syllabes sur l’ardoise blanche des pages. Tout ce blanc aveuglant qui, sous les signes du langage, serait a priori la seule possible traduction de l’absence définitive et de ce que l’on devine du néant. Reste à cet homme qui, désormais, ne peut s’écrire qu’au passé, ne peut plus désormais marcher qu’en dehors / de ses pas, ne peut plus se faire que voix sans voix, et pour qui le printemps ne sera plus jamais qu’en recul sur la terre, ne lui reste que le recours d’écrire sur la neige cette lente douleur qui l’habite et poser ses vaines questions sur le velours / du quotidien.
« Vanité des vanités, tout est vanité ! » se lamente Cohélet dès les premiers mots qu’il prononce dans le livre de L’Ecclésiaste. Et il poursuit ainsi : « Quel profit l’homme retire-t-il des peines qu’il se donne sous le soleil ? Une génération s’en va ; une génération lui succède ; la terre cependant reste à sa place. Le soleil se lève, le soleil se couche ; puis il regagne en hâte le point où il doit se lever à nouveau. »
Le Bruit des nuits pourrait alors, si Léon Bralda décidait de s’en tenir là (Ô jeune gars qui ne fait que rêver / qui se meut vers la mort), se contenter de n’être qu’un « Memento Mori » qui, si l’on se réfère aux premières phrases de l’Ecclésiaste, se poursuivrait en paragraphes résignés évoquant le sens de la vie – ou l’apparente absence de sens – , proclamant avec fatalisme la futilité et l’inanité de toute action humaine, sage comme fou connaissant le lot commun de la mort. Mais, comme nous le dit encore la page de présentation du texte, c’est aussi « un texte plein de cette voix qui porte aux confins des jeunes années, où s’amalgament les souvenirs d’enfance et les croyances en l’avenir », souvenirs de querelles enfantines et de jeux où « l’on meurt pour de faux » (Des jeux pleins / au bord de la chaussée / ont des millions d’années). Turbulences de ces vies jeunes qui se construisent dans l’échange des coups ou, comme aussi la sienne, cherchant la plénitude / en un lieu sans saison, cette vie jeune / prenant l’ombre pour la lumière / faisant château des silices et du sel / armure d’une écorce / pour un coléoptère.
Alors écrire, écrire encore, écrire noir sur blanc, en dépit de la mort et de son inconsolation, et du déchirement de l’irrémédiable séparation, un canif enfoncé dans le cœur, mais sachant qu’au négoce des mots / une image se forme : // immensité recluse / dans le verger / de mes nuits blanches.
Car c’est de l’écriture que ces mots peuvent naître, où la mémoire se ressource, l’absence s’apprivoise, où le chagrin devient fertile et l’espérance plus têtue encore : Que tes nuits échappent / à la blancheur / des marbres. // Qu’elles soient rectitudes / aux méandres des mots.
Oui, le deuil peut être fertile quand l’absence / accomplit / le fruit / de toute absence.
Ce blanc, alors, qu’affouille et creuse l’écriture, pour y révéler ce qui s’y trouve enfoui, ne serait donc pas exactement le vide de l’absence et du néant, mais le lieu d’une intime résurrection car, ainsi que l’écrit Kandinsky, si « le noir est comme un bûcher éteint, consumé, qui a cessé de brûler, immobile et insensible comme un cadavre sur qui tout glisse et que rien ne touche plus », au contraire le blanc, de la toile ou de la page, « sonne comme un silence, un rien avant tout, un commencement. » Et les mots du poème peuvent donner sens à ce blanc, qui ne peut exister que par eux, pour en faire un espace où la mémoire se ranime et l’esprit reprend souffle : Ma mère / votre voix secoue / l’insoupçonnable. // L’ombre d’un cargo / court jusqu’au bout de la digue / sur les missives blanches / d’une éparse saison. // Un être cher attend.
Ecrire, peindre, faire de tout ce blanc le lieu d’une « intime résurrection », avons-nous écrit plus haut, car ainsi que Kandinsky le pensait aussi, « l’acte de création ne peut être qu’un élargissement de l’esprit, une manière de renaître au monde », et il ajoutait ailleurs : « C’est une puissance dont le but doit être de développer et d’améliorer l’âme humaine ». Et l’artiste-plasticien, ce double de Léon Bralda, sait aussi parfaitement de quoi il parle quand il confie encore dans son entretien : « Si mon chemin dessine les contours d’une existence vouée aux arts, je le dois pour une part essentielle à cette blessure insomniaque qu’ont nourrie tout autant la mort de ma mère et mon enfance passée à la Devèze (quartier d’immeubles et de lotissements construits à la périphérie de la ville de Béziers dans les années 1960) ». Ainsi l’acte de création, écriture, peinture, serait une manière de faire face au deuil, aux turbulences de la vie, aux désordres et aux violences du monde et, en les sublimant par l’art, d’en nourrir les raisons de ses choix de vie, d’en faire les ferments d’une pensée qui saurait même contrarier la mort, comme une ombre a fait feuillage / de tous ses souvenirs. C’est ainsi qu’il écrit, en parlant de lui-même :
Se vit lui-même, encore, / dans l’accomplissement du monde. // Il sonda le poids fabuleux des couleurs / en fit l’événement et sa finalité // cherchant les croix dans le matin / fouinant les étalages / les allées de commerce // (…) goûta le fruit des mots / allant de leur colère // (…) et pour quel cri, aussi ? // Se demandant : qui a vu Dieu ?
C’est pour la densité des émotions que l’écriture de Léon Bralda sait mettre en œuvre que ce livre vaut, et par lui-même et pour ce qu’il nous apprend des thèmes et des éléments qui traversent sa poésie, notamment ceux de la nuit et de la mort, de ses irréductibles angoisses comme de sa sourde mélancolie, de l’enfance et de l’innocence première, perdue mais partiellement reconquise. Mais aussi, et toujours, malgré tout, de cet élan vital qui le porte vers la lumière et dont nous recevons l’éclat. A quoi nous rajouterons volontiers que sa poésie a cette qualité de présence qu’ont les écrits qui s’arrachent tout saignants de la vie et dont chaque mot dit ce qu’il dit, et plus encore, et autre chose aussi, nous ouvrant à ces autres chemins par quoi la poésie nous devient territoire d’errance infinie.
Michel Diaz, 31/05/20